27/05/2019
Etre intégral, an-arque, de la société des castes à la société des classes
Tout être intègre devient ce que j’appelle un être intégral en accédant à la plénitude. En conséquence, être intégral, l'Anarque (concept créé par l'écrivain allemand Ernst Jünger) l'est forcément.
Concrètement, l'Être intégral, pourtant libre, n'est pas nécessairement un homme libéral. Le premier se rapporte à une forme de transcendance individuelle et à la permanence ; des choses étrangères au deuxième – d’autant plus dans sa version moderne, qui ne date plus d’hier – car il est amoureux de la concurrence, de l'immédiateté, plus généralement de l'éphémère. Nous pouvons vulgariser leur opposition ainsi : le premier est motivé par la Force de l’Esprit – concept sur lequel je reviendrai dans un autre article –, le deuxième par la Force de la Matière. En tant que force cependant, la seconde, elle aussi, déboucherait logiquement sur une forme de spiritualité. Effectivement, l’individu néolibéral peut toujours « jurer » sur une doctrine de l’utilitarisme matérialiste dans le sens où il sacralise l’attachement aux biens et aux plaisirs matériels.
L’Être intégral n’a pas nécessairement la même activité principale toute sa vie. Dans tous les cas, cependant, il approfondit réellement ce qu’il a entrepris. D’abord, il cherche naturellement à comprendre. Ce qui peut demander du temps. Et le temps, ce n’est pas quand même pas forcément de l’argent… Il s’agit de comprendre le Monde donc soi et les autres ainsi que les règles de la nature, qui traversent aussi bien le minéral, le végétal, l’animal que l’humain. Le savoir-faire qui découle de cette compréhension se rapporte au savoir-vivre. Nous sommes alors meilleurs pour les autres, visée essentielle de toute spiritualité digne de ce nom.
Chez l’Être intégral, nous pouvons apprécier la permanence de son désir d’approfondir. Il cherche à détenir des aptitudes à se défendre moralement mais aussi physiquement – en pratiquant, par exemple, un sport de combat –, à développer en même temps sa spiritualité, à travailler en aidant les autres ou en créant, en aimant le travail bien fait. Outre sur les relations sociales, il peut trouver matière à méditer à travers des domaines très variés : des mathématiques (avec leur portée philosophique) à la boxe (et ses techniques associées), d’une fabrication améliorée du pain (pour gagner en saveur) à la maîtrise de son instrument de musique.
L’Anarque est maître de soi dans l’absolu. Tel l’être tripartite que chaque individu aspire à être pour atteindre la plénitude, l’Être intégral aime maîtriser des domaines en relation à la fois aux oratores, aux laboratores et aux bellatores, qui correspondent aux trois castes structurant les sociétés traditionnelles indo-européennes. Je rappelle que – définis ainsi par le linguiste, comparatiste et philologue Georges Dumézil (1898-1986) – les oratores sont « ceux qui prient », les bellatores « ceux qui combattent » et les laboratores « ceux qui travaillent ». D’où le schéma tripartite. Ces trois castes concernent certes l’organisation des sociétés précédentes, ils se calquent, dans le cas français, sur les trois ordres de l’Ancien régime ; à savoir respective-ment le clergé, la noblesse (en l’occurrence, la noblesse d’épée) et le tiers-état.
Par souci de contemporanéité du concept, je dirais donc que – comme l’homme est un être de corps, d’âme et d’esprit – l’Être intégral est un être moral et travailleur qui sait se battre pour se défendre.
Après l’incompétence inconsciente puis consciente, puis en-core la compétence consciente, l’Être intégral atteint enfin la compétence inconsciente. Il y découvre alors la transcendance.
Aussi, l’aura de l’Être intégral rassure. L’Être intégral est, tel l’Anarque, un être parfaitement accompli dans son intégrité. Il est acteur de sa vie, certainement pas spectateur. Il n’est pas nécessairement anarque. Leurs différences peuvent être d’ordre éthique, et sur le plan même de l’anarchisme. Aussi, l’Anarque peut vivre sa vie plus passivement qu’un être intégral. Ce qui intéresse l’Anarque avant tout, c’est de connaître le bonheur en lui et autour de lui. Par exemple et contrairement à l’Anarque, l’Être intégral peut être pleinement engagé dans une cause politique. Pleinement dans le sens où l’accord est profond entre son intégrité et son engagement. Tandis que l’Anarque entend toujours conserver un certain recul pour ne pas risquer de se perdre sur le chemin du combat politique. L’Être intégral, par sa posture intègre et son émancipation notamment spirituelle, est prêt pour être un rebelle authentique. En même temps, en raison de sa spiritualité lui attribuant une certaine sagesse, l’Être intégral peut ne pas chercher particulièrement à être une valeur ajoutée dans un monde de spectateurs. Ou plutôt, il est une valeur ajoutée mais il reste humble ou bien il s’en rend difficilement compte. Et puis cela peut sembler compliqué d’atténuer le risque de chaos lorsque lesdits spectateurs incarnent sans s’en rendre compte la décivilisation à travers leur absence de respect des traditions – entretenant une certaine solidarité populaire –, de sens des limites, de conscience morale qui en dépend et fournit nécessairement une conscience sociale et, si collectivement approfondie, une conscience de classe. Ces spectateurs se défendront-ils, au moins par instinct, face à des rebelles de pacotille – tels les télégraphistes d’un empire quel qu’il soit – défendant des intérêts qui ne sont pas les leurs ni donc ceux de leur classe ni ceux de leur pays ?
Car, au passage, la classe (société moderne) a remplacé la caste (société traditionnelle). Chose réalisée avec l’effondrement du schéma tripartite (déjà abordé dans cette partie) par la Révolution française. A alors été opérée la disparition du clergé et de la noblesse ayant entraîné la domination économique des individus les plus riches du tiers-état (1), ce dernier étant l’uni-que caste restante qui, selon la théorie révolutionnaire, devait s’émanciper dans sa totalité en devenant peuple souverain. Ce-pendant, la précédente domination allait donner les mutations les plus radicales du capitalisme, trouvant pourtant des justifications dans le libéralisme économique des philosophes des Lumières. Nous avons pu alors distinguer trois classes sociales : supérieure (financière et dominante), moyenne (entrepreneuriale), ouvrière (dominée).
Si des penseurs de la Tradition trouvent que les castes d’autrefois étaient faites pour cohabiter harmonieusement, Karl Marx, lui, va parler, à juste titre, d’antagonismes de classes suc-cédant au schéma tripartite. En effet, les précédentes classes ne peuvent qu’entretenir rapport de forces et conflits d’intérêts. D’où la naissance d’idéaux révolutionnaires tels le communisme prônant un renversement des rapports de force par la dictature du prolétariat donc la domination du plus grand nombre, re-présenté par la classe ouvrière – aujourd’hui, nous la confondrons plus largement au salariat.
Le philosophe politique Pierre-Joseph Proudhon pense, de son côté, que la classe authentiquement révolutionnaire est la classe moyenne dans la mesure où elle est détentrice à la fois d’une force de capital et d’une force de travail, qui évidemment s’évaluent bien différemment de la force de capital de la classe supérieure et de la force de travail de la classe ouvrière. Dans De la capacité politique des classes ouvrières, Proudhon écrit : « La centralisation politique et la féodalité capitaliste et mercantile sont alliées contre l'émancipation des travailleurs et le progrès des classes moyennes. » L’espoir se situe alors dans l’alliance entre la classe moyenne et la classe ouvrière. Et, pour ce faire, il faut miser sur le rôle de l’éthique comme résultat d’une conscience à la fois morale et sociale devant se retrouver chez les représentants de la classe moyenne afin qu’ils se sensibilisent à la condition de ceux qu’ils emploient – la classe ouvrière – et reformer – ou plutôt faire naître enfin réellement – une forme de tiers-état solidaire (2). En attendant, cette dernière classe, avec sa propre conscience, doit œuvrer pour une « démocratie ouvri-ère » qui « affirme son droit, dégage sa force et pose aussi son idée ».
Des décennies plus tard, l’écrivain anglais George Orwell, dans Le Quai de Wigan, disait à son tour : « Le mouvement so-cialiste doit obtenir, avant qu’il ne soit trop tard, l’assentiment d’une classe moyenne exploitée. » Encore des dizaines d’années après, l’économiste contemporain Jacques Sapir nous dit dans une enquête sur le chômage en France (30 décembre 2013) retrouvable sur son blog RussEurope : « Il faut le dogmatisme d’un Jean-Luc Mélenchon [un des meneurs politiques du mouvement politique appelé le Front de gauche] pour ne pas comprendre qu’il y a aujourd’hui plus de choses en commun entre un salarié de petite entreprise et son patron, confrontés l’un et l’autre au risque de fermeture, qu’entre ces personnes et les dirigeants des grandes entreprises, ou l’élite « compradores » (3) qui désormais gouverne. »
En même temps, ne perdons pas conscience que la nocivité n’est pas exclusive à la classe supérieure. En effet, chaque classe se constitue d’éléments nocifs compte tenu du principe d’unicité individuelle : des individus éventuellement égoïstes et malhonnêtes, narcissiques et saboteurs, cupides et manipulateurs, sans loyauté, sans droiture, sans fiabilité.
-------
NOTES (1) L’avis d’Henri Guillemin sur la Révolution française
L’historien Henri Guillemin (1903-92), dans sa conférence da-tant du 12 févier 1970 sur le célèbre meneur révolutionnaire Maximilien Robespierre, nous dit que ce dernier va s’apercevoir, précisément après la séance de l’Assemblée nationale du 27 oc-tobre 1789, que « ce qu'on a appelé la révolution française » est « une rixe de possédants », « une bagarre de nantis » entre « richesse mobilière et richesse immobilière […] sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la Cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs ». J’ajoute que ces derniers pou-vaient, bien sûr, avoir des revendications légitimes mais récupé-rées et instrumentalisées par les tenants de la première richesse citée, qui sont les hommes les plus riches du Tiers-état – soient les bourgeois. Les tenants de la seconde richesse citée sont les membres de la Noblesse et du Clergé.
En outre, Guillemin critique la Fête de la Fédération du 14 juil-let 1790. En allusion aux « gardes nationales qui font tenir tran-quille » paysans et ouvriers « rassemblés à Paris, pour dire : nous sommes les maîtres, nous avons les armes », il affirme que cette fête ne relève pas d’un patriotisme mais du « premier con-grès armé de la bourgeoisie ». Dans son texte Sur l’organisation des gardes nationales, Robespierre dénonce alors la volonté de transférer le pouvoir politique aux « castes fortunées » et de « di-viser la nation en deux classes, dont l'une ne semblerait armée que pour contenir l'autre ».
(2) Le désir d’union du peuple français au-delà de la classe ouvrière, par Georges Marchais
Tirer moralement la classe moyenne vers des principes de solidarité avec la classe ouvrière, voilà une posture jugée soit naïve soit, selon un certain communisme authentique, scandaleuse puisque la dictature du prolétariat qu’il défend n’appelle à aucune concession vis-à-vis de la classe moyenne – encore moins, bien entendu, vis-à-vis de la classe supérieure. Néanmoins, le secrétaire général du Parti communiste français de 1972 à 1994 Georges Marchais, à travers sa volonté d’unir le peuple français, semblait appuyer le besoin de cette précédente solidarité. Effectivement, cette union est, je le cite, celle « de tout notre peuple », à savoir l’union de :
– la classe évidemment « la plus immédiatement [et] vitalement intéressée à débarrasser le pays de la domination du grand capital, c’est-à-dire la classe ouvrière » (groupe 1) ;
– « l’immense masse des salariés, des techniciens, ingénieurs et cadres, des enseignants, des intellectuels et artistes » (groupe 2) ;
– « des paysans travailleurs, des artisans et des petits commerçants, des petits entrepreneurs » (groupe 3) ;
– « des jeunes travailleurs, des étudiants et des lycéens » (groupe 4).
En d’autres termes, « c’est le rassemblement de toutes ces couches sociales, de toutes les forces démocratiques, ouvrières et nationales, de tous ces hommes et de toutes ces femmes, quelle que soit leur philosophie ou leur croyance, quelle qu’ait été aussi la famille politique à laquelle ils avaient estimé jusqu’ici devoir se rattacher ». Par conséquent, nul besoin d’être « d’accord sur toutes choses. Il suffit que nous souhaitions, les uns et les au-tres, un changement démocratique, une société plus juste et plus libre ». (Le défi démocratique, 1973)
Même si nous trouvons cette ligne politico-sociale intéressante, nous pouvons toutefois craindre quelques problèmes limitant l’étendue de la solidarité trans-classe en question :
– le groupe 2 peut être en carence à la fois d’une conscience ouvrière (groupe 1) et d’une conscience entrepreneuriale (groupe 3). Car il est éloigné des contraignants principes de réalité économiques (le petit salaire de l’ouvrier, la gestion économique d’une entreprise par le « petit patron » ou le travailleur indépendant) et de responsabilités (force de travail reposant sur l’ouvrier, force de capital reposant exclusivement sur le « petit patron ») ;
– des éléments du groupe 4, selon leur conditionnement par les systèmes éducatif et économique, aspireront à faire partie du groupe 2 ou du groupe 3 et auront, selon leur origine de classe (et la culture correspondante), une conscience ouvrière plus ou moins développée (groupe 1) ;
– la typologie des postes ouvriers concerne naturellement le groupe 1 mais plus largement le groupe 2 (du manœuvre à l’ouvrier qualifié puis spécialisé), ainsi que le groupe 4 (l’ap-prenti). Ce qui peut entretenir une certaine divergence d’intérêts économiques et sociaux selon les postes de chacun.
(3) « Comprador » est un mot venant du portugais et désignant « acheteur ». C’est le philosophe français d’origine grecque Nikos Poulantzas, très influencé par le marxisme, qui, le siècle dernier, utilisait ce mot pour désigner deux bourgeoisies qui s’opposent : celle intérieure – ayant de vrais intérêts dans la richesse d’un pays – et celle compradore – s’enrichissant du commerce extérieur.
15:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
14/03/2019
Georges Sorel et la violence défendable
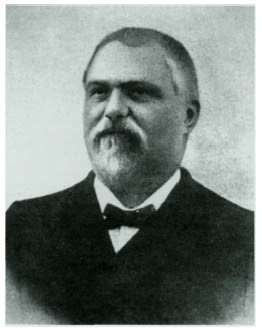 Abordons la notion de violence à travers l’exemple intéressant d’une pensée socialiste intègre ; à savoir celle de Georges Sorel, liant, surtout dans son ouvrage Réflexions sur la violence (1906), une violence jugée bénéfique avec les vertus suivantes, retrouvable dans l'éthique de la chevalerie, chère au célèbre écrivain et politique André Malraux, qu'il retrouvait également dans le bushido :
Abordons la notion de violence à travers l’exemple intéressant d’une pensée socialiste intègre ; à savoir celle de Georges Sorel, liant, surtout dans son ouvrage Réflexions sur la violence (1906), une violence jugée bénéfique avec les vertus suivantes, retrouvable dans l'éthique de la chevalerie, chère au célèbre écrivain et politique André Malraux, qu'il retrouvait également dans le bushido :
– politesse, bienveillance, compassion et générosité (les unes pouvant, de la première à la dernière, s’imbriquer aux autres) dans la conscience d’un bon sens et d’un héritage populaire local, régional et national conçu comme précieux ;
– loyauté, fidélité à soi (honneur)
et droiture (rectitude : rigueur et ouverture d’esprit), fiabilité, sincérité. Tout ceci amène au refus de la servitude et de la capitulation (se démettre plutôt que se soumettre) et fait naturellement appel au courage.
Car peut-il y avoir violence dans la maîtrise de soi – alors non écrasée par l’audace – et justifiée par le courage de l’homme moral et révolté ?
Georges Sorel (1847-1922), philosophe et sociologue français, grand théoricien du syndicalisme révolutionnaire inspiré à la fois du marxisme et de l’anarchisme, idéalisait le prolétaire chez qui il relevait un courage particulier : celui de défendre son honneur tel un héros détenant une certaine morale ouvrière (au temps de Sorel, les prolétaires étaient très généralement des ouvriers).
Sorel opposait farouchement le prolétariat à la bourgeoisie, la seconde comprenant ses « grands penseurs » dont on « pourrait se demander si toute la haute morale […] ne serait pas fondée sur une dégradation du sentiment de l'honneur » (citation tirée des Réflexions sur la violence).
Dans un autre ouvrage, La Mort de Socrate, le philosophe en question parle de la « démoralisation extrême » de ces classes sociales pouvant se passer de travailler et/ou vivant des privilèges matériels et financiers des pouvoirs économiques et politiques.
À partir de là, le socialiste révolutionnaire justifie son attachement à la notion de travail – qu’il voit comme force nécessaire de production et de création – ainsi que l’usage de la violence à condition qu’elle ne soit pas gratuite mais qu’elle contribue bien à l’autonomie de la classe ouvrière. D’où ces propos : « Répondre par des coups aux avances des propagateurs de paix sociale, cela n’est pas assurément conforme aux règles du socialisme mondain [...] mais c’est un procédé très pratique pour signifier aux bourgeois qu’ils doivent s’occuper de leurs affaires et seulement de cela. » (Réflexions sur la violence) Pour Sorel, il en va tout bonnement de la sauvegarde de la moralité. Le socialisme de cet homme est révolutionnaire par sa validation de la lutte des classes qui, selon le philosophe Julien Freund (1921-1993), renoue « avec les traditions de l'héroïsme, de la générosité et des formes chevaleresques d'autrefois ». Ce socialisme est donc critique à l’égard de celui du célèbre meneur socialiste de l’époque Jean Jaurès jugé comme quelqu’un de trop mou sur le plan de la transcendance et manquant de radicalité. « Jaurès aurait dit : « Je n’ai pas la superstition de la légalité. Elle a eu tant d’échecs ! Mais je conseille toujours aux ouvriers de recourir aux moyens légaux ; car la violence est un signe de faiblesse passagère. » (Réflexions sur la violence) (1)
Freund nous informe, de surcroît, que la violence que préconise Sorel est « celle de l'audace du soldat, capable de se sacrifier au service de la collectivité et de sa transformation éthique ». Le révolutionnaire incapable de « l'audace décrite dans les épopées » peut « tirer un trait sur la révolution » ; même s’il ne s’agit pas, pour Sorel, de « justifier les violents, mais de savoir quel rôle appartient à la violence des masses ouvrières », comme il l’écrit dans La décomposition du marxisme en 1908.
Il critique ainsi la démocratie elle-même dans la mesure où la seule visée morale de celle-ci est le pacifisme ; elle ne propose, autrement dit, aucune vision particulière du progrès moral dont dépend pourtant le progrès social. Devenant démocratie d’opi-nions et de marché – donc démocratie bourgeoise et libérale –, son pouvoir est axiologiquement neutre (2), pour reprendre un concept du sociologue Max Weber abordé dans mon ouvrage L’Anarque. La démocratie, perçue comme telle, n’incarne alors aucune vertu citée dans la partie précédente. Pire encore, dans le cas où ses représentants – la critique sorélienne se faisant surtout sur le parlementarisme démocratique – se sentent en danger, ils peuvent user d’une violence qui, elle, sera « cruelle et brutale » (expression de Freund) donc illégitime.
Opposé à elle, le socialisme doit donc constituer une éthique avant tout, c’est-à-dire – dans les mots de Freund – « une con-duite de la vie, une manière de retrouver le sens de l'honneur, de la noblesse d'âme, de l’héroïsme et du sublime ». L’opposition totale au capitalisme ne se fait pas simplement économiquement ou socialement mais aussi moralement et spirituellement. Nous pouvons, par conséquent, qualifier le socialisme de Sorel d’idé-aliste. Dans Revue de Métaphysique et de Morale en 1899, ce sociologue nous dit : « Le but final n'existe que pour notre vie in-térieure [...] il n'est pas en dehors de nous ; il est dans notre propre cœur. »
En résumé, Sorel conçoit la violence comme un moyen de la morale pratique socialiste, en précisant que cette violence n’est, pour reprendre des termes de Freund, ni « brutalité bestiale »
ni « rage destructrice » ni « haine aveugle » mais « l'expression d'une volonté consciente des prolétaires qui traduisent leurs idées en actes ». Car l’éthique de ces derniers « s'éprouve dans des actes, elle exige la force de caractère individuelle, le sens de la responsabilité et du courage collectif, justement parce qu'elle violente ainsi les excuses intellectuelles ». Par exemple, la grève générale érigée en mythe doit être salutaire pour l’homme moral. Puisque, malgré certains préjugés contemporains, celui-ci, selon Freund en parlant toujours des idées de Sorel, n'est pas voué à la « niaiserie » ni au « sentiment de culpabilité humanitariste » ni à la « pleurnicherie sur les vicissitudes humaines ».
Pourquoi préférer la grève générale aux autres grèves, spécialement contextualisées et localisées ? Tout simplement parce que les deuxièmes ne font jamais trembler réellement et totale-ment la classe supérieure. Sorel nous dit dans ses Réflexions sur la violence : « Je comprends que ce mythe de la grève générale froisse beaucoup de gens sages à cause de son caractère d’infinité. […] Tant que le socialisme demeure une doctrine entière-ment exposée en paroles, il est très facile de le faire dévier vers un juste milieu ; mais cette transformation est manifestement impossible quand on introduit le mythe de la grève générale, qui comporte une révolution absolue, […] qui donne au socialisme une valeur morale si haute et une si grande loyauté. »
Précisons que, dans le même ouvrage, Sorel défend le concept de mythe en tant que tel car les mythes, telles des allégories entretenant l’union et la mobilisation d’un groupe humain, sont des « moyens d’agir sur le présent ». Ensuite, « toute discussion sur la manière de les appliquer matériellement sur le cours de l'histoire est dépourvue de sens. C'est l'ensemble du mythe qui importe seul ».
En particulier, le mythe de la grève générale est celui « dans lequel le socialisme s'enferme tout entier, c'est-à-dire une organi-sation d'images capables d'évoquer instinctivement tous les sentiments qui correspondent aux diverses manifestations de la guerre engagée par le socialisme contre la société moderne ». Ainsi, il n’est pas « utile de raisonner sur les incidents qui peu-vent se produire au cours de la guerre sociale et sur les conflits décisifs qui peuvent donner la victoire au prolétariat ; alors mê-me que les révolutionnaires se tromperaient, du tout au tout, en se faisant un tableau fantaisiste de la grève générale, ce tableau pourrait avoir été, au cours de la préparation à la révolution, un élément de force de premier ordre, s'il a admis, d'une manière parfaite, toutes les aspirations du socialisme et s'il a donné à l'ensemble des pensées révolutionnaires une précision et une raideur que n'auraient pu leur fournir d'autres manières de penser ».
Une dernière remarque : en raison de sa conception de la violence, Sorel s’opposera à la philosophie des Lumières étant à l’origine de la démocratie parlementaire qu’il dénonce et vouant généralement un culte au pacifisme qui dépendrait du commerce (justification de l’existence du capitalisme).
Je termine cette partie avec des propos de Sorel issus de la fin de ses Réflexions sur la violence. Intéressants dans tous les cas, ils peuvent sembler au mieux idéalistes, au pire irréalistes et désuets compte tenu notamment de l’affaiblissement, en Occi-dent, de la conscience révolutionnaire authentique par le développement du secteur tertiaire et l’expansion du capitalisme moderne soutenue par la puissance des organisations politiques et économiques supranationales. « La violence prolétarienne a une tout autre signification historique que celle que lui attribuent les savants superficiels et les politiciens ; dans la ruine totale des institutions et des mœurs, il reste quelque chose de puissant, de neuf, d'intact, c'est ce qui constitue, à proprement parler, l'âme du prolétariat révolutionnaire ; et cela ne sera pas entraîné dans la déchéance générale des valeurs morales, si les travailleurs ont assez d'énergie pour barrer le chemin aux corrupteurs bourgeois, en répondant à leurs avances par la brutalité la plus intelligible […] C'est à la violence [prolétarienne] que le socialisme doit les hautes valeurs morales par lesquelles il apporte le salut au mon-de moderne. »
Toujours est-il qu’avec la crise économique actuelle et l’effondrement économique qui nous pend au nez, les mœurs et institutions artificielles érigées par les mondialistes peuvent bel et bien tomber en « ruine totale ». L’espérance se situe alors dans toutes les composantes populaires qui parviennent encore à résister tant bien que mal à ces précédentes mœurs et institutions, à vivre dans la Décence commune (contre la précédente déchéance commune). Décence commune, ou ordinaire : concept de l’écrivain britannique George Orwell (comme quoi, un Georges peut en cacher un autre) redéfini par le philosophe contemporain Jean-Claude Michéa comme notamment un « mixte, historiquement constitué, de civilités traditionnelles et de dispositions modernes qui ont jusqu’ici permis de neutraliser une grande par-tie de l’horreur économique ». (L’Enseignement de l’ignorance).
NOTES (1) Les « procédés anarchistes » contre les « grands pontifes socialistes »
Georges Sorel, en accord avec les anarchistes méprisant les politiciens socialistes, aurait souscrit, je pense, aux propos suivants d’Émile Henry (1872-1894), jeune militant anarchiste guillotiné à la suite d’attentats dont il était l’auteur : « J’avais suivi avec attention les événements de Carmaux. Les premières nouvelles de la grève m’avaient comblé de joie : les mineurs paraissaient disposés à renoncer aux grèves pacifiques et inutiles, où le travailleur confiant attend patiemment que ses quelques francs triomphent des millions des compagnies. Ils semblaient entrés dans une voie de violence qui s’affirma résolument le 15 août 1892. Les bureaux et les bâtiments de la mine furent envahis par une foule lasse de souffrir sans se venger : justice allait être faite de l’ingénieur si haï de ses ouvriers, lorsque des timorés s’interposèrent. Quels étaient ces hommes ? Les mêmes qui font avorter tous les mouvements révolutionnaires, parce qu’ils craignent qu’une fois lancé le peuple n’obéisse plus à leurs voix, ceux qui poussent des milliers d’hommes à endurer des privations pendant des mois entiers, afin de battre la grosse caisse sur leurs souffrances et se créer une popularité qui leur permettra de décrocher un mandat – je veux dire les chefs socialistes – ces hommes, en effet, prirent la tête du mouvement gréviste. On vit tout à coup s’abattre sur le pays une nuée de messieurs beaux parleurs, qui se mirent à la disposition entière de la grève, organisèrent des souscriptions, firent des conférences, adressèrent des appels de fonds de tous les côtés. Les mineurs déposèrent toute initiative entre leurs mains. Ce qui arriva, on le sait. La grève s’éternisa, les mineurs firent une plus intime connaissance avec la faim, leur compagne habituelle ; ils mangèrent le petit fonds de réserve de leur syndicat et celui des autres corporations qui leur vinrent en aide, puis au bout de deux mois, l’oreille basse, ils retournèrent à leur fosse, plus misérables qu’auparavant. Il eût été si simple, dès le début, d’attaquer la compagnie dans son seul endroit sensible, l’argent ; de brûler le stock de charbon, de briser les machines d’extraction, de démolir les pompes d’épuisement. Certes, la compagnie eût capitulé bien vite. Mais les grands pontifes du socialisme n’admettent pas ces procédés là, qui sont des procédés anarchistes. À ce jeu il y a de la prison à risquer, et, qui sait, peut être une de ces balles qui firent merveille à Fourmies. On y gagne aucun siège municipal ou législatif. Bref, l’ordre un instant troublé régna de nouveau à Carmaux. La compagnie, plus puissante que jamais, continua son exploitation et messieurs les actionnaires se félicitèrent de l’heureuse issue de la grève. Allons, les dividendes seraient en-core bons à toucher. »
(2) Une violence défendable car opposée aux pacifismes insidieux
Chez Max Weber, la neutralité axiologique est fondamentalement l’attitude du sociologue « n’émettant aucun jugement de valeur dans ses travaux », autrement dit, devant « prendre en compte, sans jugement personnel, les valeurs morales, les mœurs et les coutumes concernées dans les rapports sociaux qu’il analyse » (L’Anarque).
La neutralité axiologique de l’État libéral signifie, sinon, que, sur « le plan des valeurs (morale, éthique, religion), […] il ne doit à aucun moment incarner ni donner un jugement » (L’Anarque). Ce qui ne veut pas dire que l’État libéral est « apolitique ».
À notre époque et sous la houlette de la gauche libérale – donc, entre autres, du politiquement correct –, la neutralité axiologique sert à une pacification idéologique de la société et laisse libre cours à une « pacification » par le commerce qui ravit la droite libérale. Je mets des guillemets car, si officiellement la mondialisation se veut « heureuse » par le libre échange intégral, les choses sont différentes dans le quotidien des classes labo-rieuses. La pacification en question débouche plutôt, concrète-ment, dans un asservissement populaire par notamment le consumérisme et le salariat généralisés. L’homme lui-même devient marchandise – donc outil de consommation – puisqu’il doit sa-voir « se vendre » sur le marché du travail, stimulant les règles anti-libertés d’une concurrence acharnée. En réalité, nous évoluons donc bien moins sous le règne de « la paix par le commerce » que sous celui d’une violence économique qui déshumanise.
À savoir aussi qu’une politique de gauche peut parfois engendrer plus de violence économique qu’une politique de droite dans la mesure où, dans les couches populaires, la pilule est censée mieux passée sous l’étiquette « de gauche ». Car il existe ces refrains intellectuels et, plus globalement, cette pseudo-éthique moderne intégrés dans une idéologie du progrès, nommée progressisme, actuellement dominante et publiquement portée par les appareils politiques dits « de gauche ».
Nous pouvons résumer ce double processus de pacification dans la formule suivante : la gauche est l’idéologie et la droite le commerce. En même temps, je peux dire que le commerce idéalisé en Loi du Marché relève aussi d’une idéologie. Je dirais cependant qu’elle est surtout une stratégie économique de l’hyperclasse dans le but d’asseoir sa domination à la fois économique et politique – puisqu’elle contrôle les ficelles de la « politique politicienne » pour, justement, faire mieux passer la pilule précédente. (L’hyperclasse comprend les dirigeants des organismes économiques inter-nationaux, « les patrons de multinationales, ceux des principaux groupes pétroliers et des grandes banques mondiales (l’aristocratie financière), et ces intellectuels et économistes en tous genres, se voulant déracinés pour s’assurer d’être en dehors de toute sensibilité morale qui compromettrait leur mépris des réalités sociales élémentaires et des spécificités culturelles de tel ou tel peuple ».)
Une remarque historique : une forme de progressisme a donné le pacifisme de gauche d’entre les deux guerres mondiales du XXe siècle. Le fameux « jamais plus la guerre ! » comme mot d’ordre de ce pacifisme a freiné, chez un certain nombre de ses représentants, l’entrée en résistance voire amené à la collaboration avec les Nazis. À l’inverse, des gens issus de la droite, ne suivant pas de doctrine particulière, ont su répondre naturellement et plus facilement à l'appel de la liberté, aussi bien extérieur à eux (Charles De Gaulle) qu'intérieur (instinct de révolte, fibre anarchique).
Quant à l’Union européenne, ne repose-t-elle pas sur ce précédent mot d’ordre en ayant vendu, telle une piqûre de rappel pacifiste s’assurant d’assommer les démocraties nationales, le libre échange intégral – institutionnalisant une liberté du commerce adaptée à la modernité du néo-capitalisme – comme forcé-ment vertueux, censé nous protéger de toute guerre intra-européenne ?
13:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
11/08/2016
Briser le lien consommateur - producteur, l'un des objectifs du mondialisme
 « Les délocalisations enrichissent les riches des pays pauvres au détriment des pauvres des pays riches et des pays pauvres. » (James Goldsmith, homme d’affaires franco-britannique, 1933-97)
« Les délocalisations enrichissent les riches des pays pauvres au détriment des pauvres des pays riches et des pays pauvres. » (James Goldsmith, homme d’affaires franco-britannique, 1933-97)
« Faisons en sorte […] que le marché africain soit le marché des Africains : produire en Afrique, transformer en Afrique, et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin, et consommons ce que nous produisons, au lieu d’importer. » (Ex-trait du discours à Abdis-Abeba, le 29 Juillet 1987, du chef de la révolution burkinabé Thomas Sankara qui lui a peut-être valu la mort)
Il peut sembler contradictoire, illogique, de considérer que l'oligarchie capitaliste mondiale veuille à la fois appauvrir les peuples et faire de leurs constituants de simples consommateurs individualistes. Car comment consommer si nous n'avons plus d'argent ?
C'est là que l'aspect purement économique du mondialisme entre particulièrement en compte : il s'agit de se servir de la mondialisation des techniques de transport et de communication pour favoriser au maximum la délocalisation non seulement de la production mais aussi de la consommation (*). De cette façon, l'objet produit « ici » doit pouvoir être acheté par une personne située à l'autre bout de la planète, et inversement. Nous ne sommes plus à l'époque du célèbre industriel Henry Ford qui disait : « Je paie mes salariés pour qu’ils achètent mes voitures. » Le consommateur, dans un territoire donné, n'est plus le producteur de ce même territoire. La violence sociale est mondialisée. La solidarité de classe, qui naturellement se fait d'abord avec nos proches issus de la même classe sociale, doit être atomisée également. Par exemple, le néo-prolétaire français doit pouvoir rentrer chez lui et acheter un bien sur Internet fabriqué par des étrangers exploités dans leur propre pays.
L'aspect culturel du mondialisme sert aussi cette logique. Car il faut créer des désirs d'achats concernant des biens issus de culture étrangère afin de s'assurer de la mondialisation des transactions. Tout enracinement, tout attachement à la proximité, doit être anéanti. Notamment l'enracinement moral et l'attachement familial et amical, afin que le travailleur du nouveau siècle, nomade de la modernité, ne soit pas trop affecté par son départ pour aller gagner sa graine à l’autre bout de la Terre éventuellement, quittant ainsi ses parents, ses amis et même ses enfants. Phénomène économique, social et culturel inédit dans l’histoire et humainement dévastateur.
En opposition radicale à cette mondialisation, de la production et de la consommation, orchestrée par la classe supérieure internationale, l’anarchisme conservateur incarne alors l’autochtonie autogestionnaire.
(*) Le mythe insidieux de la croissance
Les citations sont ici tirées de l’entrevue de Jean-Claude Michéa (juillet 2008) pour la revue À contretemps. La croissance – relative à l’augmentation de la production sur le long terme et érigée en mythe par l’oligarchie libérale – cherche en permanence à justifier les phénomènes de délocalisation ; mythe ayant bien sûr, « dans le cas du commerce des armes » (« machines de mort […] destinées à tuer, de préférence, des civils innocents »), « des effets dont le caractère indécent saute immédiatement aux yeux. Mais la logique est exactement la même qu’il s’agisse d’avions Rafale livrés à une « dictature amie » ou de jeux vidéos destinés à nos adolescents. Dans tous les cas, la survie des unités de combat engagées dans la terrible guerre économique mondiale dépend uniquement de leur capacité à produire à un prix toujours plus bas les différents produits qui pourraient se vendre à l’autre bout du monde ; que ces produits n’aient strictement aucune valeur d’usage, qu’ils s’avèrent nuisibles à la santé physique des individus ou même qu’ils soient de nature à détruire leurs capacités intellectuelles ou morales ».
En outre, les catastrophes naturelles (exemple : tsunami) ou matérielles (exemple : voitures brûlées par centaines comme chaque soir de la Saint-Sylvestre depuis plusieurs années en France) sont « bonnes pour la croissance » dès lors qu’elles « feront marcher le commerce », en l’occurrence du logement et de l’automobile.
Aussi, nous comprendrons facilement que, si un nombre relativement important de familles dans le monde était en mesure de se construire une piscine privée, ce serait également « bon pour la croissance » mais, à un moment donné, inconcevable sur le plan écologique. Plus globalement, nous ne pouvons pas exploiter de manière illimitée les ressources de notre planète non pas pour des raisons éthiques – que nous pouvons tout-à-fait légitimement avancer, sauf que là n’est pas le propos – mais pour la simple et bonne raison que celles-ci sont limitées. « Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas. » (Tatanka Yotanka alias Sitting Bull, célèbre guerrier sioux)
Il faut, dès lors, savoir remettre en cause la conception du bonheur à travers l’accumulation matérielle illimitée. Épuiser les ressources, malmener l’environnement – avec ses conséquences néfastes (pollution) –, le mythe de la croissance implique aussi des inégalités sociales toujours plus importantes. Il ne peut qu’arranger certains groupes d’individus au détriment de la condition d’autres individus ( 8.2. Les orwelliens ou la gauche conservatrice).
Ne pas oublier non plus un autre mythe – propre à l’histoire européenne –, celui de l’euro, qui dépouille des États européens – l’utilisant comme monnaie nationale – de leur souveraineté monétaire et ne permet pas la dévaluation dans un pays donné, selon notamment le coût de production nationale. Les responsables d’entreprises – de taille non conséquentes obligatoirement – sont donc, au moins inconsciemment, encouragés à délocaliser dans le but d’obtenir de la main d’œuvre « moins chère » dans d’autres continents. Louison Chimel
14:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
18/07/2016
L'abécédaire de la langue des oiseaux
La "Langue des oiseaux" est une langue très volatile, c’est-à-dire très subtile. Elle est utilisée par les alchimistes depuis toujours pour transmettre la philosophie du grand œuvre et ses secrets de fabrication.
C’est en nous amusant que je m’en vais vous en transmettre les arcanes. C’est ensemble que nous allons nous user l’âme, cette âme qui nous agite et que nous devons vider pour laisser passer la lumière.
Par Patrick Burensteinas. Extrait de l'Orbs, l'autre Planète. #1, Un Fil d’or. Arts, sciences, humanités et consciences.
Il y a trois manières d’entendre la langue des oiseaux, ce qui nous donnera certaines clefs de compréhension.
La première est le jeu de mots : par exemple, en voyant quelqu’un qui porte des lunettes nous "entendons" lu net, c’est bien ce à quoi sert l’objet. À travers ces jeux de mots, nous allons trouver une démarche et commencer à comprendre les propos souvent obscurs que tient un alchimiste.
En alchimie, nous ne parlons pas de marche, mais de démarche, c’est sans doute ce qui nous pousse à nous arrêter : en effet, la quête de l’alchimiste n’est pas celle du mouvement mais celle de l’immobilité.
Cette démarche va se faire d’une certaine manière indiquée par les jeux de mots. Tout ce qui est autour de nous s’appelle la matière. Ce que nous entendons maintenant l’âme a tiers. Si l’âme a tiers, il y a deux tiers d’autre chose. Notre démarche, notre point d’arrêt va passer par trois passages, trois pas sages. Un pas à travers l’âme, un pas à travers le corps et un pas à travers l’esprit.
C’est ce que les anciens appelaient corpus, animus, spiritus. Mais ce peut aussi être le minéral, le végétal et l’animal.
Si nous sommes des apprentis sages, en finissant ces trois pas sages, nous pourrons ainsi trépasser. Rien ne ressemble plus à la mort que l’immobilité. Mais la mort, c’est l’âme hors et donc pas forcément quelque chose que nous devons craindre. Pour trouver l’immobilité, trois passages nous permettront de vivre une mort apparente.
Évidemment, nous nous imaginons être incapables de faire le chemin seul. C’est pour cela que nous avons inventé des intercesseurs entre les hommes et les dieux. Les Anges que nous pouvons bien sûr entendre maintenant "En je". Nous savons donc où ils sont. Il semble donc y avoir quelque chose à trouver à l’intérieur de nous.
II va falloir faire une démarche
Emprunter trois passages
Trouver quelque chose qui est à l’intérieur de soi
Approcher une mort apparente ou plutôt une mort des apparences
Quand nous arrivons dans ce monde, nous apparaissons. Quand nous quittons ce monde, nous disparaissons. Nous ne faisons donc que paraitre.
Le contraire de la vie c’est la mort. Mais quel est le contraire de la naissance ?
Eh bien c’est être. Dès qu’on naît on n’est plus.
Nous pouvons donc conclure que nous ne naissons qu’une fois et qu’après une succession de vie et de mort nous sommes de nouveau.
L’initié est sur le chemin de la Lumière. Ce qui ne veut pas dire qu’il l’a atteinte. Pour l’atteindre, il faudra qu’il perce les apparences, qu’il n’y ait plus de différence entre l’intérieur et l’extérieur. Qu’il y ait un lien, un pont entre l’intérieur et l’extérieur, une espèce d’arc en je. C’est le passage de l’ange (en je) en l’archange (l’arc en je). Alors, il n’y aura plus de différence entre l’intérieur et l’extérieur et tout sera Un.
Notre quête est la quête du point commun (comme un). L‘incompris deviendra l’Un compris. Même si cela n’est qu’un jeu, il nous met quand même sur le chemin.
Ce que nous venons de faire est la première manière d’entendre la langue des oiseaux, le jeu de mots. C’est la manière la plus simple.
La deuxième manière d’utiliser cette Langue est toujours un jeu de mots mais cette fois avec une clef cachée à l’intérieur.
Par exemple, l’alchimiste visite le musée de Cluny et se rend dans la salle où est exposée la tapisserie "La Dame à la licorne". La dame présente dans cette tapisserie est souvent considérée à tort comme étant Diane de Poitiers.
L’alchimiste, à la vue de cette tapisserie, a instantanément une indication du métal et en quelle quantité il doit l’utiliser dans son Œuvre. En effet, il ne lira pas Diane de Poitiers, mais Diane de poids tiers. Il se trouve que dans le langage symbolique, les dieux et les déesses représentent des planètes et des métaux. Diane, déesse lunaire, représente la lune et la lune, l’argent. L’adepte utilisera donc un tiers de poids d’argent. Pour bien confirmer cela, l’écu qui est sur la tapisserie représente trois croissants de lune.
La troisième manière d’entendre cette langue, et de loin la plus intéressante, est une interprétation lettre par lettre.
Chaque lettre a un sens et la manière dont elle s’articule avec sa voisine donne une clef.
Par exemple, un mot important pour nous : le mot MORT. L’interprétation en est la suivante :
La forme de la première lettre (M) évoque une femme qui accouche, c’est la création, la mère. Nous pouvons aussi entendre « AIME ». Il y a ensuite, le (O) pour eau, le (R) pour l’air, et le (T) pour la terre.
Nous pouvons constater qu’il manque un élément. C’est le Feu. Eh bien c’est celui qui l’est. Ne disons-nous pas d’un défunt qu’il est feu et c’est sans doute pourquoi ici il s’éteint. Ce qui nous permet de ne plus avoir peur de la mort puisque le Feu continue son chemin ailleurs.Ce travail lettre par lettre peut être utilisé à peu près pour tout, aussi bien pour des mots communs que des prénoms, des marques ou des sigles. En comprenant la combinaison de ces lettres, un certain nombre de clefs très intéressantes apparaissent. femininbio.com - mars 2014
11:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
15/06/2016
Débat Chimel Onfray - Alain de Benoist sur Pierre-Joseph Proudhon
15:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
08/06/2016
Sentiments d'éternité
13:58 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
01/06/2016
De l'église au supermarché
 Autrefois le dimanche, les Français allaient spontanément à l’église. Aujourd’hui, ils vont spontanément au supermarché. Spontanément, en effet. Cela va de soi puisqu’il faut remplir le frigidaire afin de nourrir la famille. La semaine, n’ont le temps de faire les courses ni le père ni la mère – devenue, comme lui, un simple salarié des temps modernes avec matricule. Aller à la messe, c’est aujourd’hui ringard : attention aux moqueries. Aller à la mosquée, alors là, c’est forcément pour préparer une attaque à la bombe, dirons les Occidentaux aucunement initiés à la théologie qui, après le « touche pas à mon pote » scandé par leurs parents dans les années 1980, devraient inventer une action nommée : « Touche pas à ma France américaine ! » Qu’il n’y ait, à côté de ça, plus de caissière – ni de caissier ! – au poste d’essence du supermarché ne doit pas les offusquer. C’est certes un emploi en moins, mais que cela change-t-il dans notre quotidien ? Que je ne puisse pas, en revanche, mettre de l’essence à n’importe quelle heure de la journée, même en pleine nuit, c’est inadmissible ! Il faut préférer unanimement, à l’humanité, la disponibilité permanente des machines… Louison Chimel - Extrait de Anarchiste conservateur
Autrefois le dimanche, les Français allaient spontanément à l’église. Aujourd’hui, ils vont spontanément au supermarché. Spontanément, en effet. Cela va de soi puisqu’il faut remplir le frigidaire afin de nourrir la famille. La semaine, n’ont le temps de faire les courses ni le père ni la mère – devenue, comme lui, un simple salarié des temps modernes avec matricule. Aller à la messe, c’est aujourd’hui ringard : attention aux moqueries. Aller à la mosquée, alors là, c’est forcément pour préparer une attaque à la bombe, dirons les Occidentaux aucunement initiés à la théologie qui, après le « touche pas à mon pote » scandé par leurs parents dans les années 1980, devraient inventer une action nommée : « Touche pas à ma France américaine ! » Qu’il n’y ait, à côté de ça, plus de caissière – ni de caissier ! – au poste d’essence du supermarché ne doit pas les offusquer. C’est certes un emploi en moins, mais que cela change-t-il dans notre quotidien ? Que je ne puisse pas, en revanche, mettre de l’essence à n’importe quelle heure de la journée, même en pleine nuit, c’est inadmissible ! Il faut préférer unanimement, à l’humanité, la disponibilité permanente des machines… Louison Chimel - Extrait de Anarchiste conservateur
12:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
20/05/2016
Conscience nationale et conscience de classe
 « Là où il y a différenciation naissent la haine et la lutte. Cela se voit dans le cas d'un peuple qui opprime un autre peuple, et cela explique l'invincible répugnance qu'inspire l'antipatriotisme, lequel fait abstraction du besoin d'indépendance que tout peuple éprouve en face d'un autre peuple, besoin qui est au fond de l'âme humaine et qui explique les manifestations les plus incroyables du sacrifice. Il est complètement inutile de raisonner un tel sentiment. Du reste, si l’antipatriotisme veut raisonner et rester conséquent avec lui-même, il conduit tout droit à la négation de la lutte de classe, tout en voulant l'affirmer plus énergiquement. Le besoin de l'indépendance de classe repose lui-même sur un fait sentimental. Qui trouve illogique le sentiment de l'indépendance nationale doit trouver tout aussi illogique le sentiment de l'indépendance de classe. Si la patrie est là où l'on est bien, la classe est celle qui nous fait vivre le mieux. » (le socialiste napolitain Arturo Labriola (1873-1959) : Karl Marx, l'économiste, le socialiste, 1900)
« Là où il y a différenciation naissent la haine et la lutte. Cela se voit dans le cas d'un peuple qui opprime un autre peuple, et cela explique l'invincible répugnance qu'inspire l'antipatriotisme, lequel fait abstraction du besoin d'indépendance que tout peuple éprouve en face d'un autre peuple, besoin qui est au fond de l'âme humaine et qui explique les manifestations les plus incroyables du sacrifice. Il est complètement inutile de raisonner un tel sentiment. Du reste, si l’antipatriotisme veut raisonner et rester conséquent avec lui-même, il conduit tout droit à la négation de la lutte de classe, tout en voulant l'affirmer plus énergiquement. Le besoin de l'indépendance de classe repose lui-même sur un fait sentimental. Qui trouve illogique le sentiment de l'indépendance nationale doit trouver tout aussi illogique le sentiment de l'indépendance de classe. Si la patrie est là où l'on est bien, la classe est celle qui nous fait vivre le mieux. » (le socialiste napolitain Arturo Labriola (1873-1959) : Karl Marx, l'économiste, le socialiste, 1900)
00:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
09/05/2016
L'art critique et justicier, de Proudhon à Camus
Citation tirée d’un texte de Pierre-Joseph Proudhon sur le prêtre et l’artiste qui, selon lui, ont un crucial point commun : « Entre le prêtre, dont la conscience n’est affermie qu’en Dieu, et l’artiste, dont le génie ne se repaît que d’idéalités formelles, spirituelles, d’idoles, l’analogie est complète : ils périront l’un et l’autre de la même dissolution. » (Le texte en question est tiré d’un ouvrage appelé Controverse sur Courbet et l'utilité sociale de l'art, édité par Christophe Salaün en 2011, dans lequel on retrouve aussi des textes d’Émile Zola.)
À propos de l’art en particulier, Proudhon le voit – dans Du Principe de l’art et de sa destination sociale – comme « une représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes, en vue du perfectionnement physique et moral de notre espèce ». Le Bisontin défend plus précisément un « art critique » ou encore un « art justicier », un art non seulement subjectif mais aussi forcément objectif, servant la cause collective. Autrement dit, un art qui (en citant toujours ce dernier livre) :
– « commence par se faire justice lui-même en se déclarant serviteur, non de l’absolu, mais de la raison pure et du droit ;
– « ne se contente plus d’exprimer ou de faire naître des impressions, de symboliser des idées ou des actes de foi ; mais qui à son tour, unissant la conscience et la science au sentiment, discerne, discute, blâme ou approuve à sa manière ;
– « aux définitions de la philosophie et de la morale, vient ajouter sa sanction propre, sa sanction du beau et du sublime ;
– « se ralliant au mouvement de la civilisation, en adoptant les principes, est incapable de se pervertir par l'abus et l'idéal, et de devenir, lui-même instrument et fauteur de corruption. »
J’en profite pour, à présent, vous faire partager ce très beau passage d’Albert Camus (1913-60) tiré de L’homme révolté : « L'art […] nous apprend que l'homme ne se résume pas seulement à l'histoire et qu'il trouve aussi une raison d'être dans l'ordre de la nature. […] Sa révolte la plus instinctive, en même temps qu'elle affirme la valeur, la dignité commune à tous, revendique obstinément, pour en assouvir sa faim d'unité, une part intacte du réel dont le nom est la beauté. On peut refuser toute l'histoire et s'accorder pourtant au monde des étoiles et de la mer. Les révoltés qui veulent ignorer la nature et la beauté se condamnent à exiler de l'histoire qu'ils veulent faire la dignité du travail et de l'être. Tous les grands réformateurs essaient de bâtir dans l'histoire ce que Shakespeare, Cervantes, Molière, Tolstoï ont su créer : un monde toujours prêt à assouvir la faim de liberté et de dignité qui est au cœur de chaque homme. La beauté, sans doute, ne fait pas les révolutions. Mais un jour vient où les révolutions ont besoin d'elle. Sa règle qui conteste le réel en même temps qu'elle lui donne son unité est aussi celle de la révolte. Peut-on, éternellement, refuser l'injustice sans cesser de saluer la nature de l'homme et la beauté du monde ? Notre réponse est oui. Cette morale, en même temps insoumise et fidèle, est en tout cas la seule à éclairer le chemin d'une révolution vraiment réaliste. En maintenant la beauté, nous préparons ce jour de renaissance où la civilisation mettra au centre de sa réflexion, loin des principes formels et des valeurs dégradées de l'histoire, cette vertu vivante qui fonde la commune dignité du monde et de l'homme, et que nous avons maintenant à définir en face d'un monde qui l'insulte. » Louison Chimel
14:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
02/05/2016
Exemples historiques de prises de parole/décision en assemblée (Etienne Chouard)
15:59 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
22/04/2016
Se plaindre ou se révolter ?
« Ce que je demande, moi, c'est que les hommes soient ordinairement bons, tolérants, compréhensifs et assez généreux. » (Georges Brassens)
Dans mon schéma précédent, la colère en question est la colère par générosité – la « colère généreuse » (expression orwellienne) – dont la dimension morale ne repose pas sur la haine mais sur le mépris à l’égard des esprits manipulateurs, oppresseurs, autoritaires et totalitaires. Le sentiment de justice nourrissant cette colère nous amène à juger qu’il existe des individus à défendre, d’autres à combattre – ou, du moins, dont les agissements sont à neutraliser. La haine peut être l’origine d’une colère mais il est alors question d’une colère par égoïsme ou par envie. Elle rend floue toute distinction des individus selon leur moralité. Et ce, tout simplement parce que l’être haineux a éteint sa propre moralité. Par conséquent, il n’y a pas, en vérité, de haine des autres sans haine de soi. De surcroît, nous pouvons dire que la haine est l’indigne mépris – inconsidéré, illimité – dans la mesure où l’être haineux ne fait plus preuve de décence, alors que le digne mépris est la conséquence d’un discernement moral – c’est le mépris du chevalier combattant au nom de certaines vertus qui, en même temps, ne lui autorisent pas d’user de n’importe quel moyen pour arriver à ses fins.
Une anecdote : nous étions, l’autre jour, quatre collègues, à discuter ensemble. Deux femmes, deux hommes. L’un des deux hommes est quelqu'un de très timide et peu spontané. Une des deux femmes lui a conseillé, afin de parvenir à s’ouvrir davantage aux autres, de se mettre en colère contre lui-même. L'autre femme a souhaité qu’il soit capable d’être plus généreux. Je pense que c’est par association de ces deux idées que se développe notre décence, c’est-à-dire notre moralité à visée pratique, notre capacité à donner et à reconnaître que nous avons reçu afin de savoir rendre.
Effectivement, la colère dite contre soi, c’est l’ardente volonté de notamment trouver sa place dans la société – donc de se faire respecter. À condition, sinon la dynamique en question est bancale et non valide, d’être respectable – donc d’être entre autres un minimum généreux.
Il faut, bien entendu, ne pas opposer colère « contre soi » et colère « pour soi » dans le sens où la première est, en fait, une colère « pour tous » donc entre autres pour soi. De la colère « contre soi » à la colère « pour tous » ; soit la colère pour se trouver – ou se retrouver – mais aussi pour trouver les autres, apprendre à aller à leur rencontre et les apprécier.
Ce qui est rigoureusement opposé à l’exposition d’une colère par générosité est finalement l’intériorisation d’une haine profonde. Ou bien l’être haineux laisse éclater sa haine. Son âme est éventuellement prête à devenir celle d’un bourreau. Son désir de domination a, selon Orwell, des origines infantiles comprenant la haine œdipienne mais aussi la rage, l’envie, le ressentiment, la tristesse, la jalousie, la vengeance (1). « Aussitôt que la révolte, oublieuse de ses généreuses origines, se laisse contaminer par le ressentiment, elle nie la vie, court à la destruction et fait se lever la cohorte ricanante de ces petits rebelles, graines d’esclaves, qui finissent par s’offrir, aujourd’hui, sur tous les marchés d’Europe, à n’importe quelle servitude. Elle n’est plus révolte ni révolution, mais rancune et tyrannie. » (Albert Camus, L’homme révolté)
À présent, nous pouvons associer la colère par générosité à l’action de se révolter (ou se rebeller), la colère par égoïsme ou par envie à l’action de se plaindre.
Me révolter et me plaindre laissent respectivement entendre que :
– j’ai su couper le cordon – du moins mentalement si je suis socialement aliéné – avec tous ceux qui incarnent une forme d'autorité – qui ne sont pas que familiaux mais aussi, par exemple, professionnels – et je considère que le salut vient d’abord de moi-même et non d’autrui. Me révolter, c’est me responsabiliser. C’est porter mon courage aux rangs des combats pour la dignité qui ne peuvent laisser les autres indifférents. Dans L’homme révolté, Albert Camus déclare : « Je me révolte donc nous sommes. » Il écrit aussi ce passage qui colle non seulement à cette partie mais aussi à ma conception de l’Anarque : « La mesure n'est pas le contraire de la révolte. C'est la révolte qui est la mesure, qui l'ordonne, la défend et la recrée à travers l'histoire et ses désordres. L'origine même de cette valeur nous garantit qu'elle ne peut être que déchirée. La mesure, née de la révolte, ne peut se vivre que par la révolte. Elle est un conflit constant, perpétuellement suscité et maîtrisé par l'intelligence. Elle ne triomphe ni de l'impossible ni de l'abîme. Elle s'équilibre à eux. Quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de l'homme, à l'endroit de la solitude. Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche n'est pas les déchaîner à travers le monde ; elle est de les combattre en nous-même et dans les autres ; »
– je considère que l’autre est pleinement responsable de ma condition qui ne me convient pas, qu’en plus j’espère qu’il saura changer pour mon bien-être. Me plaindre, c’est rester dans ma propre aliénation mentale que je fais subir aux autres. « Rien que le fait de se plaindre peut donner à la vie un attrait qui la fait supporter : dans toute plainte il y a une dose raffinée de vengeance, on reproche son malaise, dans certains cas même sa bassesse, comme une injustice, comme un privilège inique, à ceux qui se trouvent dans d’autres conditions. » (Friedrich Nietzsche, Le crépuscule des idoles) Louison Chimel
13:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
15/04/2016
Le Mal est quantitatif, le Bien est qualitatif (2/2)
 Sachons toujours, malgré la pollution du quantitatif, discerner le Beau et le Bon, même s’ils semblent êtres rares à croiser sur notre chemin. La rareté doit nous donner l’idée de ce qui est précieux donc de ce qui est vraiment de qualité.Il faut savoir dénicher le Bien sous les multiples couches insidieuses du Mal. C’est le « diamant caché sous une montagne d’excréments » de George Orwell dans Le Quai de Wigan même s’il désigne ainsi, pour être précis, l’idéal mêlant « justice et liberté ». « Plus c’est gros, plus cela passe », le Mal, c’est le culot outrageant, la perversité – éventuellement intellectualisée –, la démesure au service de la destruction des parcelles du Bien. Et même si, en tel lieu et avec telles personnes le véhiculant mal ou pas du tout, le Bien est très minoritaire, il sera vainqueur. Sa nature le destine à cela.
Sachons toujours, malgré la pollution du quantitatif, discerner le Beau et le Bon, même s’ils semblent êtres rares à croiser sur notre chemin. La rareté doit nous donner l’idée de ce qui est précieux donc de ce qui est vraiment de qualité.Il faut savoir dénicher le Bien sous les multiples couches insidieuses du Mal. C’est le « diamant caché sous une montagne d’excréments » de George Orwell dans Le Quai de Wigan même s’il désigne ainsi, pour être précis, l’idéal mêlant « justice et liberté ». « Plus c’est gros, plus cela passe », le Mal, c’est le culot outrageant, la perversité – éventuellement intellectualisée –, la démesure au service de la destruction des parcelles du Bien. Et même si, en tel lieu et avec telles personnes le véhiculant mal ou pas du tout, le Bien est très minoritaire, il sera vainqueur. Sa nature le destine à cela.
Et puis, finalement, le Beau et le Bon sont-ils si difficiles à trouver ? Dans L’Anarque, je rends hommage aux plaisirs des sens.Le Beau, c’est d’abord la nature, avec sa parfaite et complexe autogestion, qui suit sa loi dictée peut-être par un esprit qui lui est propre. « L'homme est l'espèce la plus insensée, il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible ! Sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce Dieu invisible qu'il vénère. » (Hubert Reeves, astrophysicien et écologiste franco-canadien)Au passage, je crois de plus en plus que c'est au milieu des forêts et des champs que nous sommes le mieux reliés au Ciel – avec son monde invisible, s’il doit exister. Il y a une meilleure connexion entre la Terre et le Ciel en ces lieux, à l’environnement le plus authentique car naturel et non transformé – je dirais même travesti, quand les bâtiments y sont froids, mornes et polluants – par la main bâtisseuse. C’est loin des interférences nous reliant à notre matérialité, à nos souffrances et attachements terrestres, que nous pouvons envisager la communion entre la Terre et le Ciel. En outre, regardons les étoiles. Peut-être, d’ailleurs, que nous avons toujours l'esprit un peu plus libre quand nous croyons à notre bonne étoile, même si ceci paraît parfois bien difficile étant donnée l’éventuelle amorce de notre destin aux indignes conditions de vie.Le Bon, ce sont les produits de la nature assouvissant nos besoins primaires : les fruits et les légumes, les vertus de la baignade ou de l’ensoleillement. En vérité, le sens des limites originel se situe bien dans la protection de la nature et de ce qu’elles nous offrent. Notre plasticité morale, le sens le plus vertueux du progrès, dépendent vraiment de la sauvegarde de la nature et donc de la sollicitude pour mon prochain puisque lui et moi sommes nous-mêmes produits de la nature, notre culturalité dépendant de capacités offertes par la nature. Ainsi, le Beau c’est également le sourire d’un enfant, le Bon la bienveillance du parent. Louison Chimel, extrait de Anarchiste conservateur. Louison Chimel, extrait de Anarchiste conservateur
15:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
10/04/2016
Le Mal est quantitatif, le Bien est qualitatif (1/2)
 Si je peux souvent me retrouver dans le pessimiste en joie décrit dans cette partie, il y a des sorties optimistes qui me touchent pour la simple et bonne raison que, par esprit de révolte, nous voulons, par exemple, croire que nos valeurs l’emportent sur le terrain politique. J’ai plusieurs fois, dans ce livre mais aussi dans d’autres – comme mon premier essai philosophique Résigné et Révolté –, expliqué la nécessité de la révolte.Dans son combat contre l’emprise de l’Empire nord-américain sur son pays, le chef d’Etat vénézuélien Nicolas Maduro affirme ainsi son espérance dans son discours du 9 mars 2015 : « Ce qui doit triompher triomphera. » J’ai beaucoup aimé cette expression. Le triomphe, dans le Tarot de Marseille, est symbolisé par la lame du Chariot. Soit le guerrier triomphant sur son char. Il est parvenu à dompter la matière et reconnaît le rôle suprême de la morale – comme synthèse de toutes les éthiques et de tous les sentiments de justice – dans la gestion des affaires publiques. « Jamais l'amour du bien ne s'allumera dans les cœurs à travers toute la population, comme il est nécessaire au salut du pays, tant qu'on croira que dans n'importe quel domaine la grandeur peut être l'effet d'autre chose que du bien. » (Simone Weil, L’Enracinement)
Si je peux souvent me retrouver dans le pessimiste en joie décrit dans cette partie, il y a des sorties optimistes qui me touchent pour la simple et bonne raison que, par esprit de révolte, nous voulons, par exemple, croire que nos valeurs l’emportent sur le terrain politique. J’ai plusieurs fois, dans ce livre mais aussi dans d’autres – comme mon premier essai philosophique Résigné et Révolté –, expliqué la nécessité de la révolte.Dans son combat contre l’emprise de l’Empire nord-américain sur son pays, le chef d’Etat vénézuélien Nicolas Maduro affirme ainsi son espérance dans son discours du 9 mars 2015 : « Ce qui doit triompher triomphera. » J’ai beaucoup aimé cette expression. Le triomphe, dans le Tarot de Marseille, est symbolisé par la lame du Chariot. Soit le guerrier triomphant sur son char. Il est parvenu à dompter la matière et reconnaît le rôle suprême de la morale – comme synthèse de toutes les éthiques et de tous les sentiments de justice – dans la gestion des affaires publiques. « Jamais l'amour du bien ne s'allumera dans les cœurs à travers toute la population, comme il est nécessaire au salut du pays, tant qu'on croira que dans n'importe quel domaine la grandeur peut être l'effet d'autre chose que du bien. » (Simone Weil, L’Enracinement)
Qu’elle se calque sur un enseignement religieux ou non, nous avons tous une vision du Bien et du Mal. Dans tous les cas, le verbe « devoir » prend tout son sens dans le Bien. Devoir faire le mal sonne faux. Ce qui, donc, doit forcément triompher est le Bien et non le Mal. Et parce que c’est le Bien, il triomphera tôt ou tard. Car la qualité supérieure du Bien l’emporte sur une quantité même importante de Mal. Par l’attirance pour la qualité, nous saurons trouver des armes adéquates face au Mal, même extrêmement conquérant.Le Mal est sans qualité. Sauf, évidemment, pour ceux qui le défendent. Mais alors qualité est seulement efficacité. De surcroît, nous disons souvent qu’un défaut est l’excès d’une qualité. Le Mal est donc quantitatif.
Le Mal, c’est l’ensemble des formes d’impérialismes piétinant la dignité d’autrui, les armes de destruction massive utilisées par l’Empire nord-américain pour ravir les ultras riches et oisifs de ce Monde, la programmation « très réfléchie » des multiples déportations et assassinats par les régimes soviétiques et nazis du siècle dernier. Le Mal, c’est l’exploitation en masses – enfants y compris dans certaines zones du Monde – et le sous-prolétariat généralisé sous tutelle oligarchique, l’industrialisation agro-alimentaire et banalisée de l’abattage des animaux. C’est la société occidentale de surconsommation, l’hyperpollution de l’air et des mers par des phénomènes inédits d’urbanisation et d’industrialisation, l’abrutissement collectif par la minutieuse répétition médiatique de certaines idées entraînant peurs et divisions au sein des peuples, le déni total d’un sens des limites en cherchant, par exemple, à légaliser la pédophilie. C’est le mensonge et la manipulation servant à couvrir l’ignominie de nos élites illégitimes se tenant par la barbiche, l’accumulation et la concentration des pouvoirs, des richesses et des biens au sein de ces élites se passant de rendre des comptes à qui que ce soit.Le Mal, c’est la tentation. Pour que nous soyons tentés, le Mal (le malin) peut prendre de belles allures – c’est-à-dire charmantes et séductrices. Seulement, je peux juger qu’il arrive un jour où toute imposture est dévoilée.La tentation sous-entend, dans le monde matériel, l’attirance vers « le bas » c’est-à-dire vers une mauvaise pensée, parole, action. Tirant sur la corde de la dimension matérialiste de l’homme, le Mal est bien quantitatif encore une fois. Il prendra des apparences du Beau mais restera laid. Il ne peut pas être le Beau réellement puisqu’il n’est pas la qualité.Par ailleurs, nous associons naturellement l’idée du Beau à l’esthétique. A l’éthique tout court, est associée l’idée du Bon. Je peux juger que le Bien est la synthèse du Beau et du Bon.
Louison Chimel, extrait de Anarchiste conservateur
14:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
05/04/2016
Rassurons-nous...
 Rassurons-nous, des milliers de Français dits musulmans s’appliquent, en dignes représentants de la modernité d’inspiration principalement nord-américaine et anglo-saxonne, à consommer régulièrement du McDonald’s et du Coca-Cola. Comme leurs compatriotes d’autres confessions, ils iront au cinéma voir le dernier film de super héros sorti tout droit de l’univers des comics étasuniens ayant des pouvoirs très généralement paranormaux et agissant bien sûr « seul contre tous ». Film dont les réalisateurs, en bons propagandistes de l’ordre établi, cherchent à s’assurer de neutraliser toute conscience collective en cultivant le mythe totalement illusoire de l’unique et vraie révolte, qui, en l’occurrence, dépendrait d’un homme isolé et aux capacités hors normes.
Rassurons-nous, des milliers de Français dits musulmans s’appliquent, en dignes représentants de la modernité d’inspiration principalement nord-américaine et anglo-saxonne, à consommer régulièrement du McDonald’s et du Coca-Cola. Comme leurs compatriotes d’autres confessions, ils iront au cinéma voir le dernier film de super héros sorti tout droit de l’univers des comics étasuniens ayant des pouvoirs très généralement paranormaux et agissant bien sûr « seul contre tous ». Film dont les réalisateurs, en bons propagandistes de l’ordre établi, cherchent à s’assurer de neutraliser toute conscience collective en cultivant le mythe totalement illusoire de l’unique et vraie révolte, qui, en l’occurrence, dépendrait d’un homme isolé et aux capacités hors normes.
Gare à ce Français musulman – plus largement, à tout Musulman évoluant en Occident – qui se pose « trop de questions » dès qu’il s’en pose quelques unes, qui ne désire décidément pas entrer dans le rang des petits sujets de l’Empire, autocentrés et consommateurs. Ce monsieur sera, pour un rien, suspecté d’être un islamiste par l’oligarchie atlantiste actuelle. Car, pour elle, il n’y a pas de juste milieu concernant le « destin social » individuel : il s’agit d’être soit un soumis soit un ennemi… à/de cette modernité, avec toute l’anthropologie néolibérale et les mécanismes économiques associés.
Je finirais en rappelant, sans ironie, qu’une authentique banque islamique, elle au moins, interdit l’usure.
Louison Chimel, Cahiers d'un anarchiste conservateur
15:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
30/03/2016
Sur la pornographie moderne
 Concernant la pornographie, nous pouvons fortement désapprouver sa banalisation par Internet, rendant une infinité de vidéos accessibles à n’importe qui et à n'importe quel instant. En plus, la mise en scène de performances extrêmes – non démunies de violences – et de corps « parfaits » ou refaits, aux membres surdimensionnés, s'éloigne beaucoup de la réalité des pratiques sexuelles des gens ordinaires. Ces dernières décennies, s’est construite, en outre, une véritable industrie capitaliste de la pornographie, mettant très souvent de côté toute esthétique érotique et banalisant notamment la nudité. Nous pouvons dire, à la façon de Pier Paolo Pasolini dans ses Écrits corsaires, que la famille est aujourd’hui aux prises avec un « néo-hédonisme totalement matérialiste et laïque, aux sens les plus stupides et les plus passifs de ces termes ». Internet, de son côté, peut être très utile comme très néfaste.
Concernant la pornographie, nous pouvons fortement désapprouver sa banalisation par Internet, rendant une infinité de vidéos accessibles à n’importe qui et à n'importe quel instant. En plus, la mise en scène de performances extrêmes – non démunies de violences – et de corps « parfaits » ou refaits, aux membres surdimensionnés, s'éloigne beaucoup de la réalité des pratiques sexuelles des gens ordinaires. Ces dernières décennies, s’est construite, en outre, une véritable industrie capitaliste de la pornographie, mettant très souvent de côté toute esthétique érotique et banalisant notamment la nudité. Nous pouvons dire, à la façon de Pier Paolo Pasolini dans ses Écrits corsaires, que la famille est aujourd’hui aux prises avec un « néo-hédonisme totalement matérialiste et laïque, aux sens les plus stupides et les plus passifs de ces termes ». Internet, de son côté, peut être très utile comme très néfaste.
« Donner aux enfants des racines et des ailes » est un proverbe yiddish qui image bien la vision de l’anarchisme conservateur à propos des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants car nous pouvons logiquement comparer la tendance anarchiste aux ailes et la tendance conservatrice aux racines. Je vous renvoie tout simplement à la partie de mon livre L’Anarque nommée Autorité sur soi autolibératrice. Aux parents, donc, de :
– oser camper sur certaines limites dans le but de protéger leurs enfants, d’être vigilants à l’égard de l’utilisation d’Internet par leurs progénitures tout en étant attentifs à leurs questionnements ;
– de s’associer entre parents toujours plus et mieux pour faire de la prévention et représenter une digne contre-culture face à la pseudo-culture dominante attisant les compulsions.
Nonobstant, l’association en question doit prendre une tournure réellement politique en œuvrant idéalement pour la rupture avec le capitalisme qui donne les moyens d’exister à cette pornographie débridée :
– produisant des tonnes de vidéos et à bas coût, avec des interprètes à la fois aliénés socialement et miséreux moralement ;
– entretenant un phénomène de sexualité de substitution auprès des téléspectateurs et internautes – soient des consommateurs plus attachés à leur ordinateur que désireux de partir à la rencontre de « vrais gens ».
L’internaute devient alors un élément atomisé des classes populaires, régulièrement avide de vidéos pornos, dont des milliers sont gratuites et totalement libres d’accès. Il devient, à son tour, moralement pauvre et plus que jamais solitaire. Il lui reste alors à s’appauvrir aussi économiquement, en brûlant sa carte bancaire sur des jeux d’argent en ligne, à l’existence potentiellement remise en cause au nom d’une pensée économique radicalement opposée au système en place. Louison Chimel, Carnets d'un anarchiste conservateur
16:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
21/03/2016
Différences et ressemblances entre Socrate et le Christ
 Certains penseurs ont relevé d’intéressants points communs entre Socrate et le Christ. Citation intéressante de Jean-Jacques Rousseau dans Émile ou De l’éducation : « Socrate prenant la coupe empoisonnée bénit celui qui la lui présente et qui pleure ; Jésus, au milieu d’un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu. Dirons-nous que l’histoire de l’Évangile est inventée à plaisir ? Mon ami, ce n’est pas ainsi qu’on invente ; et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. » Socrate et le Christ meurent tous les deux injustement condamnés. Tous les deux, ils vouent leur vie à la spiritualité. Ils sont attachés de manière absolue à la vérité. Sauf que, point crucial, Socrate la recherche alors que le Christ la répand. Car le second la détient, il la symbolise même. D’ailleurs, comme il le dit au gouverneur romain Ponce Pilate, il n’est « venu dans le monde » que « pour rendre témoignage à la vérité » (Évangile selon Jean). Socrate, lui, s’il recherche la vérité dans sa forme absolue, ne la recherche pas que dans le temporel mais aussi dans l’intemporel. Ainsi, il est sensible à un « au-delà » de nos dispositions éthiques qui règleraient seulement les problèmes de la cité d’aujourd’hui. Pour Jésus, la vérité est certes en lui mais, en même temps, au-delà puisqu’il se veut le représentant de Dieu sur Terre. Également, nous pouvons faire remarquer que Jésus n’est pas contre la sexualité mais « au-delà ». Il s’en passe parce qu’il en a parfaitement les moyens. De même, il ne ressent pas le besoin de fonder une famille. Que dire alors de ceux qui jurent sur le Christ tandis que, pour eux, le sexe est banni hors mariage et qu’en outre il est un devoir de se marier et de procréer ? Le Christ est également au-delà des querelles entre les peuples, comme nous le voyons plus loin dans son dialogue avec la Samaritaine, un épisode des Évangiles. Cette façon d’être « au-delà », d’être à la fois impartial et détaché des jugements partisans et discriminants, de voir avant tout une unique humanité avec ses individus, uniques également, plaît à certains anarchistes. Jésus peut être comparé à un anarque.
Certains penseurs ont relevé d’intéressants points communs entre Socrate et le Christ. Citation intéressante de Jean-Jacques Rousseau dans Émile ou De l’éducation : « Socrate prenant la coupe empoisonnée bénit celui qui la lui présente et qui pleure ; Jésus, au milieu d’un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu. Dirons-nous que l’histoire de l’Évangile est inventée à plaisir ? Mon ami, ce n’est pas ainsi qu’on invente ; et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. » Socrate et le Christ meurent tous les deux injustement condamnés. Tous les deux, ils vouent leur vie à la spiritualité. Ils sont attachés de manière absolue à la vérité. Sauf que, point crucial, Socrate la recherche alors que le Christ la répand. Car le second la détient, il la symbolise même. D’ailleurs, comme il le dit au gouverneur romain Ponce Pilate, il n’est « venu dans le monde » que « pour rendre témoignage à la vérité » (Évangile selon Jean). Socrate, lui, s’il recherche la vérité dans sa forme absolue, ne la recherche pas que dans le temporel mais aussi dans l’intemporel. Ainsi, il est sensible à un « au-delà » de nos dispositions éthiques qui règleraient seulement les problèmes de la cité d’aujourd’hui. Pour Jésus, la vérité est certes en lui mais, en même temps, au-delà puisqu’il se veut le représentant de Dieu sur Terre. Également, nous pouvons faire remarquer que Jésus n’est pas contre la sexualité mais « au-delà ». Il s’en passe parce qu’il en a parfaitement les moyens. De même, il ne ressent pas le besoin de fonder une famille. Que dire alors de ceux qui jurent sur le Christ tandis que, pour eux, le sexe est banni hors mariage et qu’en outre il est un devoir de se marier et de procréer ? Le Christ est également au-delà des querelles entre les peuples, comme nous le voyons plus loin dans son dialogue avec la Samaritaine, un épisode des Évangiles. Cette façon d’être « au-delà », d’être à la fois impartial et détaché des jugements partisans et discriminants, de voir avant tout une unique humanité avec ses individus, uniques également, plaît à certains anarchistes. Jésus peut être comparé à un anarque.
Il existe des similitudes entre Socrate et le Christ dans la pratique de leur vocation. Tous deux n’ont rien écrit. Ce ne sont pas des intellectuels. Ils auront fait, en outre, des travaux manuels ; le premier sculpteur, le second charpentier et tailleur de pierre. Ils ne font pas de conférences dans des bureaux. Nul besoin de les payer pour les écouter. De toute façon, nous retrouvons Jésus « sans cesse en compagnie des prolétaires, des misérables, des bas-tombés, des lépreux, des malheureux de toute sorte mis au ban de la société » (Émile Armand, Mensonges de Jésuites). La philosophie, quant à elle, vaut pour la vie ordinaire et quotidienne. À partir de là, le philosophe, tel Socrate, ne peut qu’être un être social. Lui et Jésus sont dans les rues des cités ou dans les chemins de campagne, et usent uniquement de la parole : une parole désintéressée, gratuite, au langage simple, afin d’être sûrs d’être compris par tous. Aussi, ils sont vraiment ce qu’ils défendent. La distance se veut nulle entre leurs paroles, leurs actes et leurs manières de vivre. Ils n’ont, d’ailleurs, aucun bien et vivent parmi les gens pauvres. Armand, dans Mensonges de Jésuites, résume bien leur posture : « La vraie religion consiste dans une transformation intérieure, dans un renouvellement de la vie morale, dans un accord incessant entre ce qu’on dit être et ce qu’on est réellement, dans une tentative sincère pour y parvenir tout au moins, et non dans un vêtement de forme spéciale ou une récitation machinale de prières ou de textes sacrés. »
Nous pouvons trouver également que, comme Socrate en son temps, le Christ, au cours de sa rencontre avec la Samaritaine, use de la maïeutique. Qu’est-ce que celle-ci ? « L’art de faire accoucher les esprits » répond Socrate, dont la mère était sage-femme. La maïeutique est une technique de langage – reposant beaucoup sur les questionnements – pour que l’interlocuteur se rende compte de lui-même qu’il est contradictoire, ou qu’il a des certitudes qui sont fausses, ou qu’il en sait moins, ou plus, que ce qu’il croyait.
Pour mieux convaincre nos interlocuteurs, pour qu’ils intègrent d’une meilleure façon les vertus, pour qu’ils vivent vraiment en eux-mêmes une transformation morale positive, ne devons-nous pas les amener à formuler eux-mêmes des réponses ? Ainsi, l’autre, certes, contribue à la révélation mais une bonne partie de celle-ci vient de nous-mêmes.
Nous voyons que le Christ, dans son dialogue avec la Samaritaine, sait faire naître, chez l’autre, une remise en question. À sa manière, alors que, selon les mœurs ambiantes, il ne devrait pas parler avec cette femme membre d’un peuple hostile aux Juifs, Jésus chamboule les codes. En plus, il est à l’opposé de la misogynie que nous pouvons retrouver à l’époque. Pour bien des choses et à sa manière, Jésus est un révolutionnaire. Louison-Antoine
14:40 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
17/03/2016
Le néolibéralisme : un scorpion qui se mord la queue
« Le néolibéralisme, au nom de la liberté individuelle à laquelle il est fort attaché, peut, pourquoi pas, laisser entendre qu'un individu est libre d'exploiter un groupe d'individus serviles. En effet, le libéralisme, avec pour raison lui-même, peut inviter à infiniment imaginer et étendre cette liberté sans contrepartie qui maintiendrait un minimum de sens commun. Tel un scorpion qui se mord la queue, il finit tellement par ignorer le déterminisme naturel et animal de l'homme, au profit du concept de liberté individuelle devenu sacro-saint, qu'il laisse ce dernier retourner totalement à ce déterminisme. » (Louison Chimel, Rousseau contre les Lumières)
Rousseau contre les Lumières (1/3) par Chimel_Louison
16:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
10/03/2016
S'opposer à la théorie du genre
 Au nom de l’égalitarisme sexuel, il peut bien y avoir de plus en plus de femmes militaires (1) étant donnée l’évolution des techniques de guerre.
Au nom de l’égalitarisme sexuel, il peut bien y avoir de plus en plus de femmes militaires (1) étant donnée l’évolution des techniques de guerre.
En effet, une guerre, quelle qu’elle soit, est bien entendu, toujours regrettable. Or, en termes de virilité, il existe des guerres qui forcent davantage le respect que d’autres. A savoir, certains rois de France interdisaient l’usage militaire de l’arc et de l’arbalète car, ainsi, la distance avec laquelle on atteint son adversaire est beaucoup moins noble qu’avec une épée ou simplement au corps à corps. C’est pourquoi l’honneur revient au chevalier plutôt qu’à l’archer, même dans le cas où les deux ont perdu la bataille.
Que dire alors des batailles des temps modernes avec ces engins télécommandés que sont les drones, comme si l’on jouait à un jeu vidéo ? Dans ce cas, quelle virilité au combat pouvons-nous revendiquer ? C’est sûr qu’à ces postes-là nous pouvons enrôler des dizaines de femmes.
Par conséquent, au temps où les guerres ne sont plus très viriles, elles sont néanmoins plus dévastatrices, avec des carnages inédits. Même si je sais qu’il faut vivre avec son temps dans le but d’au moins survivre – mais sans, quand même, avoir l’obligation de prendre « tout » de son temps –, je reconnais du courage chez les chevaliers et les mousquetaires, ainsi que chez les hussards utilisant leur sabre, et non pas chez ces dangereux « gamers » actuels, experts en jeux vidéos en uniforme militaire.
Extrait de la partie S'opposer à la théorie du genre (livre : Les Cahiers d'un Anarchiste conservateur) d'Louison Chimel
10:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
02/03/2016
L'anarchisme conservateur, un socialisme ?
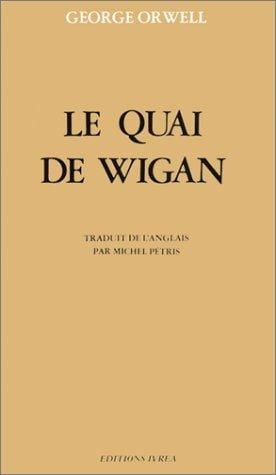 George Orwell écrit dans Le Quai de Wigan : « En ce moment, la seule attitude possible pour tout individu honnête, toute personne décente, que son tempérament le porte plutôt vers les conservateurs ou plutôt vers les anarchistes, est d’œuvrer pour l'avènement du socialisme. Autrement, rien ne peut nous sauver de la misère actuelle et du cauchemar à venir. »
George Orwell écrit dans Le Quai de Wigan : « En ce moment, la seule attitude possible pour tout individu honnête, toute personne décente, que son tempérament le porte plutôt vers les conservateurs ou plutôt vers les anarchistes, est d’œuvrer pour l'avènement du socialisme. Autrement, rien ne peut nous sauver de la misère actuelle et du cauchemar à venir. »
Si l’anarchisme conservateur est un proudhonisme alors c’est un socialisme autogestionnaire de tendance mutualiste. Or, le proudhonisme a des inspirations utopistes ; autrement dit, Pierre-Joseph Proudhon a été influencé par les toutes premières doctrines dites socialistes (1) datant du début du XIXe siècle – plus précisément, entre autres, par le Gallois Robert Owen et les Français Charles Fourier et le Comte de Saint-Simon. Aussi, notre penseur bisontin obtient un emploi intéressant dans une batellerie lyonnaise en 1843. Il rencontre alors les ouvriers de la soie lyonnais, les Canuts, rassemblés en associations mutuelles (formant la Société du Devoir mutuel), conséquences des deux insurrections sociales connues dans cette ville en 1831 et 1834. Ce qui va beaucoup influencer les thèses de Proudhon.
Il ne s’agit donc pas d’idéaliser un processus révolutionnaire rapide débouchant sur un immense soulèvement qui n’assure aucunement l’absence de déchirements postérieurs, au profit de l’installation d’une nouvelle dictature. Il faut différencier ce mythe révolutionnaire de la nécessité insurrectionnelle sur laquelle je reviens dans une autre partie. Les grèves et les manifestations changent ce qu’elles peuvent changer et ce qui est pris est pris. L’insurrection a naturellement, par rapport à la révolution, le mérite d’une plus grande immédiateté. Je rappelle, en passant, que, dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, est stipulé le droit de « résistance à l’oppression » à travers trois articles dont le suivant : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus in-dispensable des devoirs. » Étonnant, non ? En tout cas, facile à écrire, moins facile à faire. Surtout que, face à l’insurrection, nous pouvons avoir à faire aux forces de l’ordre, envoyées par le gouvernement et représentant, à ce qu’il paraît, la souveraineté populaire.
Je reviens à l’idée d’immédiateté, ces précédentes « premières doctrines » défendent l’imminence de l’organisation socialiste par l’expérience. Il faut montrer l’exemple empiriquement, ne pas garder la théorie au chaud, dans l’attente de la révolution. De toute façon, les plus grandes et vraies révolutions se font sur des générations. L’oligarchie libérale le sait très bien : elle est ce qu’elle est aujourd’hui parce qu’elle est le fruit de plusieurs épisodes politiques, de plusieurs – et plus ou moins lentes – mutations philosophiques puis culturelles puis technologiques. Extrait de la partie L'ANARCHISME CONSERVATEUR, UN SOCIALISME ? (ouvrage : Anarchiste conservateur) Louison Chimel
14:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
25/02/2016
Les vertus du chevalier (extrait)
 Pour moi, le chevalier est un exemple parfait d’être à la fois temporel et spirituel. Il est une excellente incarnation de l’être éthique – autrement dit, un être inscrit dans la société civile avec des principes chevillés au corps. Il diffère :
Pour moi, le chevalier est un exemple parfait d’être à la fois temporel et spirituel. Il est une excellente incarnation de l’être éthique – autrement dit, un être inscrit dans la société civile avec des principes chevillés au corps. Il diffère :
– d’un côté, de l’individu voué à la vie contemplative, du moine qui vit avec ses autres coreligionnaires dans un endroit reculé des cités mais qui concrètement risque de peu servir la cause commune ;
– de l’homme ordinaire à la moralité bringuebalante.
Le chevalier est admirable par son intégrité au service direct de la Cité où il vit. Il cherche à être disponible en permanence afin de protéger « la veuve et l’orphelin ». Et ce, dans la pudeur et l’humilité, le courage atteignant alors une dimension encore plus élevée.
En passant, ce modèle éthique, et masculin (jusqu’à preuve du contraire, les chevaliers sont des hommes), est fort éloigné du pseudo-modèle régulièrement mis en avant dans les médias français modernes, honorant les petites natures néo-bourgeoises qui :
– renchérissent narcissiquement sur leurs souffrances personnelles ;
– soulignent les vertus qu’elles prétendent incarner ;
– se spécialisent dans l’excuse systématique et n’assument pas, de ce fait, tout propos un soupçon vif ou viril, qui serait exceptionnellement inadapté au prêt-à-penser, avec sa civilité en carton-pâte nous faisant croire à une fraternité hypocrite capable d’embobiner seulement a priori – je dis bien : a priori –les lectrices de la presse à scandales.
Ce profil a contaminé entre autres un certain nombre de sportifs – victimes de la mode du métrosexuel regrettant publiquement un éventuel propos un peu cru vis-à-vis de leurs adversaires et dont ils sont les auteurs – ainsi que les stéréotypes cinématographiques qui, par amour de l’excès pour faire vendre, exposent des personnages masculins dont :
– le chouineur sentimentaliste et hypersensible se sapant en chemise et jean moulants et prêt à aimer « tout le monde » ;
– le haineux chronique – forcément alcoolique, drogué et/ou violent – prêt à « tuer tout le monde ».
Extrait de la partie intitulée Les vertus du chevalier, des Cahiers d'un Anarchiste conservateur (Louison Chimel)
15:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
18/02/2016
De la contre-société populaire à l'implosion révolutionnaire, au confédéralisme national (2/2)
 Pour, à présent, donner le vertige au pouvoir politique, il y a les émeutes populaires. Cela demande à ce qu'une bonne partie du peuple se fasse entendre, réussisse donc à parler, ou crier, d'une même voix. Tout ce qui se veut « nouvelles mœurs » œuvrant pour une plus grande dégénérescence éthique et un nihilisme social sont à combattre. Pourquoi se couper en deux – allusion au clivage politico-bourgeois gauche-droite – quand on s'oppose, par exemple, au mariage « pour tous » et, en même temps, à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ?
Pour, à présent, donner le vertige au pouvoir politique, il y a les émeutes populaires. Cela demande à ce qu'une bonne partie du peuple se fasse entendre, réussisse donc à parler, ou crier, d'une même voix. Tout ce qui se veut « nouvelles mœurs » œuvrant pour une plus grande dégénérescence éthique et un nihilisme social sont à combattre. Pourquoi se couper en deux – allusion au clivage politico-bourgeois gauche-droite – quand on s'oppose, par exemple, au mariage « pour tous » et, en même temps, à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ?
Je souhaite enfin aborder la nécessité du complot. Car les solutions les plus sérieuses, qui chambouleraient le plus profondément l'ordre capitaliste, ne peuvent évidemment pas être dé-voilées publiquement. D'où l'importance du secret. Parmi les sérieux révoltés, il en faut donc des visibles et des invisibles. L'entrisme est, au passage, une pratique qui a du bon. Puisque, pour mieux comprendre et combattre le système, il faut le côtoyer, le pénétrer. C'est l'honneur qui guide notre sérieux. Et il n'existe pas sans fidélité à soi. Ainsi, nous ne pouvons être fiers ni de nous ni des autres si personne n'est fidèle à soi.
En abordant l'implosion révolutionnaire par le besoin d'émeutes, de complots et de mutineries, je m'inspire de la posture de Charles Maurras issue de son livre intitulé Si le coup de force est possible, dans lequel il écrit qu' « il est permis de calculer :
– soit la mutinerie militaire ;
– soit une émeute populaire ;
– soit un complot proprement dit, ourdi par un petit nombre d'hommes persuadés que la victoire n'est pas aux gros bataillons, mais à la compagnie ou même à la section qui ose ; une maigre escouade, quatre hommes, un caporal, peuvent avoir raison de tout un régime s'ils ont bien choisi le moment et le point où frapper.
Le nombre, au vrai, importe peu. »
L'anarchisme, lui, n'est pas qu'une espérance mais – en l'occurrence, proudhonien – il est aussi un pragmatisme ne nous faisant pas perdre à l'esprit que le peuple français se forme aujourd’hui de plus de soixante-cinq millions d'habitants, que plus le nombre d'individus est grand, plus un intérêt complexe et commun à eux est difficile à être réalité. D'où, d'une part, des rôles répartis selon les compétences de chacun dans la potentialité d'une mutinerie, d'une émeute ou d'un complot ; d'autre part – et le sens de l'implosion est plus profond ainsi –, une ré-volte populaire certes éparse – aux opérations différentes d'une région à une autre, d'une grande ville à une autre – mais pré-parant non pas le retour d'un pouvoir jacobin, avec toute sa mythologie mensongère, mais la confédération.
Attention, « opérations différentes » ne signifie pas « opérations divergentes ». Compte tenu de la subsistance d’un patriotisme populaire et des piètres institutions étatiques actuelles, je conçois avec difficulté la volonté d'une libération locale majeure sans celle d'une libération nationale. Surtout que je différencie l’État de la nation ; et l'État, en bridant les intérêts de la commune, bride en même temps ceux de la nation tout entière.
Certes, en outre, les intérêts des Bretons ne sont pas identiques à ceux des Alsaciens. Seulement, l’élan patriotique peut entraîner une mobilisation à l’échelle nationale afin de com-battre les élites supranationales dont européennes. Autrement, nous sommes condamnés à un autonomisme local aliéné car dé-pendant, par les subventions, de ces élites. Il faut inverser l'actuelle pratique fédéraliste. Le pouvoir du département est la solution contre l'abus de pouvoir de la région – à tel point que tous les départements d'une région doivent déterminer eux-mêmes son pouvoir. Analogiquement, le pouvoir national est la solution contre la dictature européenne actuelle.
« Le contrat de fédération ayant pour objet, en termes géné-raux, de garantir aux Etats confédérés leur souveraineté, leur territoire, la liberté de leurs citoyens ; de régler leurs différends ; de pourvoir, par des mesures générales, à tout ce qui intéresse la sécurité et la prospérité commune ; ce contrat, dis-je, malgré
la grandeur des intérêts engagés, est essentiellement restreint. L'Autorité chargée de son exécution ne peut jamais l'emporter sur ses constituantes ; je veux dire que les attributions fédérales ne peuvent jamais excéder en nombre et en réalité celles des autorités communales ou provinciales, de même que celles-ci ne peuvent excéder les droits et prérogatives de l'homme et du citoyen. S'il en était autrement, la commune serait une commu-nauté ; la fédération redeviendrait une centralisation monar-chique ; l'autorité fédérale, de simple mandataire et fonction su-bordonnée qu'elle doit être, serait regardée comme prépondé-rante ; au lieu d'être limitée à un service spécial, elle tendrait à embrasser toute activité et toute initiative; les Etats confédérés seraient convertis en préfectures, intendances, succursales ou régies. Les corps politique, ainsi transformé, pourrait s'appeler république, démocratie ou tout ce qu'il vous plaira : ce ne serait plus un Etat constitué dans la plénitude de ses autonomies, ce ne serait plus une confédération. » (Pierre-Joseph Proudhon, Du Principe fédératif)
Louison Chimel - texte présent dans son prochain livre Anarchiste conservateur
15:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
13/02/2016
De la contre-société populaire à l'implosion révolutionnaire, au confédéralisme national (1/2)
 « Tout arrive, donc tout se peut. Il n'y a qu'à vouloir. Qu'on veuille le possible, et le réel éclot. » (Charles Maurras, Si le coup de force est possible)
« Tout arrive, donc tout se peut. Il n'y a qu'à vouloir. Qu'on veuille le possible, et le réel éclot. » (Charles Maurras, Si le coup de force est possible)
C'est plus une idée d'explosion que d'implosion qui est liée, a priori, à celle de révolution.
Seulement, le peuple, le vrai peuple – autrement dit, l'en-semble des hommes et des femmes modestes du quotidien, les détenteurs directs de la force du travail et les personnes fragiles physiquement et/ou mentalement (retraitées, handicapées) – en constituant une contre-société, ne marche plus dans la combine, a décidé de laisser s'effriter le système économique dominant dans lequel il évolue sans l'avoir choisi, ne reconnaît plus quel-conque autorité politique, judiciaire ou policière qui en dépend.
Ayant opté pour la résistance – pacifique, par exemple à la Léon Tolstoï, mais pas toujours – le peuple développe des ré-seaux de solidarité alternatifs, redéploie de l'humanité digne de ce nom, c'est-à-dire de la dignité, que l'âme des gouvernants a perdu aux seuls bénéfices de leurs intérêts particuliers.
En opposition rigoureuse au système – association de l’État et de la société –, il faut un peuple autonome et solidaire ainsi qu'une contre-société comme l'expérience d'une société décente authentique.
Nous ne cherchons pas, alors, à ce que le système explose mais qu'il implose peu à peu – qu'il s'effondre tel un château de cartes sur lequel nous soufflons lentement mais sûrement.
Nous ne sommes pas étasuniens donc nous sommes, nous français, une société sans armes, au sens propre. Il vaut donc mieux avoir de notre côté les hommes armés. L'élite bureaucratique encravatée ne peut que trembler devant la menace d'armes maniées par des professionnels. Je fais allusion à l'armée française et à l'action de mutinerie. (1)
Bien sûr, il y a, dans celle-ci, tous ces hauts gradés bien heureux de rendre service une fois, deux fois, dix fois, à l'Empire nord-américain. Il y a tous ceux qui ont laissé tomber l'amour du Pays réel – ou le réel amour du pays, comme on préfère – pour s'assurer d'une bonne gâche aujourd'hui, pour une bonne retraite de militaire demain. Leur fierté dépend malheureusement de la reconnaissance des atlantistes ou encore des mondialistes ; tant pis s'ils ne comprennent pas – ou plutôt, ne sentent pas – que la fierté est plus grande, plus pure, lorsqu'on se tourne du côté du peuple. Il ne s'agit donc pas de la fierté pour soi, qui a ses limites existentielles, mais celle pour les autres. Encore faut-il cependant que les autres soient justement un minimum fiers d'eux et osent s'indigner, souhaitent entrer en résistance. C'est George Orwell entre autres qui nous rappelle que l'exercice et la critique politiques est sans noblesse si elle n'est pas le résultat d'une authentique indignation.
En toute logique, il y a des liens entre le militaire et le héros. Souvent, le premier a voulu être un héros. Souvent, celui qui voulait autrefois être un héros s'imaginait sous un uniforme militaire. Nonobstant, il ne s'agit pas, bien sûr, d'attendre les militaires pour s’activer. Si le héros prend tout son sens dans la moralité, ou si la seconde est à son apogée en le premier, formant le sublime – « mort dans la bourgeoisie » ainsi « condamnée à ne plus avoir de morale » (2) –, alors le soldat n'a pas le mono-pole de la vertu.
De surcroît, plus nous grimpons dans la hiérarchie plus nous trouvons de la compromission chez les gradés militaires. Je préfère donner ma confiance au soldat « d'en bas » qui a cru naïve-ment mais tout à fait sincèrement servir son pays en s'engageant.
NOTES (1) Nous pouvons intégrer, dans l’acte de mutinerie, les forces de police. Le policier représente certes l'autorité étatique mais peut très bien se retourner contre sa hiérarchie et, par exemple, rejoindre l'émeute populaire – évoquée dans cette partie – puisque lui aussi est un citoyen asservi (Þ 8.6.2. L’aliénation par l’allocation. NOTE : Les corps constitués avec ou contre le peuple ?)
(2) Expression de Georges Sorel tirée de ses Réflexions sur la violence. Pour notre grand auteur socialiste, le sublime est encore, dans cet ouvrage, l'esprit du héros moral qui « se retrouve dans les groupes ouvriers […] passionnés pour la grève générale ». Car « ces groupes se représentent […] la révolution comme un immense soulèvement qu'on peut encore qualifier d'individualiste : chacun marchant avec le plus d'ardeur possible, opérant pour son compte, ne se préoccupant guère de subordonner sa conduite à un grand plan d'ensemble savamment combiné ».
Louison Chimel - texte présent dans son prochain livre Anarchiste conservateur
11:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
08/02/2016
Fédéralisme et confédéralisme : les différences
 On m’a plusieurs fois demandé la différence entre le fédéralisme et le confédéralisme. Pour faire bref, on peut faire deux différences, de degré et de nature :
On m’a plusieurs fois demandé la différence entre le fédéralisme et le confédéralisme. Pour faire bref, on peut faire deux différences, de degré et de nature :
— de degré si on juge que, dans une confédération, la décentralisation est simplement plus importante et la concentration des pouvoirs à un quelconque échelon territorial l’est moins que dans une fédération. Ainsi, un régime politique jugé confédération par les uns peut être jugé fédération par les autres. Je reviens plus loin sur cette confusion.
— de nature si les pouvoirs attribués à un échelon supérieur sont décidés démocratiquement à l’échelon inférieur. En fait, le principe confédératif repose sur l’idée d’une inversion totale des pouvoirs, revenant aux citoyens qui, d’abord au niveau communal, exercent au maximum la vie démocratique et décident eux-mêmes, par le biais de leur mandataire impératif, de ce qu’ils allouent comme pouvoir à l'échelon supérieur, le canton (fédération de communes) puis ainsi de suite.
Dans une confédération, ce sont les citoyens décident du principe de suppléance devant être assuré par l'échelon supérieur. Tandis que, dans une fédération, c’est l’État qui alloue ce qu’il veut bien allouer en termes de pouvoirs et gère ainsi lui-même l’étendue de la décentralisation et de la déconcentration.
Maintenant, du philosophe Pierre-Joseph Proudhon au politique Charles De Gaulle, l’usage des mots fédération et confédération a été plus d’une fois confondu. Disons, par exemple, que le confédéralisme peut être qualifié de fédéralisme intégral. Il peut, par ailleurs, concerner aussi bien le domaine purement politique que le domaine économique. L'autogouvernement, c'est l'autogestion dans les entreprises, si l'on suit Proudhon. Quant à De Gaulle, il était à la fois pour la régionalisation (allant dans le sens de la décentralisation) et la cogestion (association capital-travail).
A l’échelle mondiale, au passage, en suivant la précédente logique, le confédéralisme fait respecter le primat du pouvoir national sur celui continental. Ainsi, ceux qui croient que défendre le confédéralisme ou, au moins, un fédéralisme fort décentralisé fait le jeu de l’actuel fédéralisme européen se trompent. Puisque les institutions européennes sont antidémocratiques. Le pouvoir supranational y prime sur le pouvoir national. Or, le principe confédératif dit le contraire. Étant données, de plus, les actuelles circonstances géopolitiques, il faut, par pragmatisme, défendre particulièrement l’échelon national menacé. Mais ce n'est pas oublier, si on défend le précédent principe, l’auto-administration des régions, des départements, des communes pour idéal.
Enfin, le confédéralisme, bien que fort sympathique, peut sembler relever d’une utopie (anarchie). Dans la pratique, un fédéralisme très décentralisé, qui concentre, au niveau national, les pouvoirs régaliens (assurer la sécurité intérieure et extérieure (police, justice, armée) et battre monnaie) peut être salutaire (minarchie).
L’indépendance nationale ainsi que des principes moraux fondamentaux peuvent être assurés et représentés à l’échelle du pays par un roi (monarchie fédérative). Ce qui, en l’occurrence, réconcilierait la France avec le pan le plus important de son histoire.
Anarchie et monarchie, deux solutions semblant bien distinctes aux premiers abords mais qui, en même temps, peuvent s’interpénétrer. Salvadore Dali défendait bien « notre anarchie, celle d’en bas », devant être « protégée par l’ordre d’en haut ». Il ajoutait : « En haut, le maximum d'unité, en bas le maximum d'hétérogénéité. »
En complément, mon article Agoravox suivant : Le principe fédératif proudhonien
Louison Chimel
14:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
03/02/2016
Un rétroviseur, ça doit servir ! (4/4)
 NOTES (2) Condamner les arrière-pensées :
NOTES (2) Condamner les arrière-pensées :
un nouveau pas vers le « progrès »
À force de moins condamner les actes que les paroles, nous finissons par condamner les arrières pensées ! Ceci est le travail de la Police de la Pensée correcte et dominante. En effet, elle
est spécialisée dans la « criminalisation des esprits », vous condamnant – simplement moralement et symboliquement, ou réellement par la loi – si vous avez utilisé tel mot banni par cette pensée, quel que soit le contexte. Si vous ne faites qu’objecter l’une des thèses de la Pensée correcte, il se peut bien qu’automatiquement vous souteniez la parfaite antithèse. (Ce qui s’avère risible, c’est que condamner soi-disant une pensée incorrecte révèle surtout, parfois, la « mauvaise pensée » du condamnant. Car c’est lui qui, avec les propos du condamné et à l’aide d’une imagination suspecte, a fait d’étranges associations d’idées auxquelles le condamné n’avait jamais pensé.)
Si, autre exemple, un ami d’un ami d’un ami est dans le collimateur de cette police, vous êtes vous-même suspect, même si vous ne le connaissez pas du tout et n’avez rien à voir avec ce monsieur.
Enfin, il y a condamner « ce que vous alliez dire » mais aussi « ce que vous alliez faire » !
Minority report (1956) est une nouvelle de science-fiction de Philip K. Dick (1928-82) décrivant une société future où les délits qui ne sont pas encore commis peuvent être prédits par des mutants (nous parlons, en fait, de précognition). Tandis
que, normalement, nous condamnons pour des crimes réalisés, Précrime est, dans la nouvelle, l’organisation qui, à l’aide de ces mutants, permet la condamnation d’individus pour des crimes qu’ils étaient sur le point d’accomplir mais qui n’ont donc pas réellement accompli. Le fondateur de cette organisation est alors en mesure d’affirmer : « Précrime a fait reculer le crime de quatre-vingt dix-neuf virgule huit pour cent. »
Pour en revenir à la réalité, le documentaire appelé Philip K. Dick l’écrivain visionnaire (2013) nous informe qu’à Memphis, aux États-Unis, les services de police ne s’en remettent pas à des facultés de précognition mais utilisent un logiciel de probabilités et de statistiques qui fournit une carte des futures activités criminelles. Puis ils prévoient, et donc empêchent, certains crimes en fonction des zones localisées par le logiciel. Ils avancent, au final, que le taux des crimes les plus graves a diminué de 30 %. Jusqu’au jour où un équivalent de Précrime existera vraiment ?
(3) Par exemple, l’innovation comme notion chère aux transhumanistes, aux garants de l’évolution technologique, aux grands industriels rêvant d’expansion économique infinie, veut parfois se justifier par sa dimension extraordinaire. Seulement, ce qui est extraordinaire n’est pas forcément décent. On parle parfois de techniques extraordinaires de torture. Les crimes sont parfois d’une intensité extraordinaire. Les milliardaires ont un patrimoine économique extraordinaire. Ce dernier adjectif peut, par conséquent, rimer avec disproportionné et extravagant, immoral et indécent. Louison Chimel, Les Cahiers d'un Anarchiste conservateur
13:46 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
28/01/2016
Gare aux « réactionnaires », ils sont partout ! (Un rétroviseur, ça doit servir ! (3/4))
NOTE (1) Gare aux « réactionnaires », ils sont partout !
« C’était mieux, le Monde sans téléphone portable et/ou sans Internet » : voilà un exemple simple de jugements qui, même dans le cas où ils s’accompagnent d’une certaine argumentation, auront peu de mal à réveiller des préjugés chez toute personne veillant à s’adapter à la modernité (il n’y a, d’ailleurs, pas que de mauvaises raisons à cela). Quels préjugés exactement ? Ils peuvent s’exprimer par des qualificatifs uniquement injurieux com-me (pour les plus polis d’entre eux) « idiot », « stupide » ou « crétin ». Nous avons, sinon, plus élaboré et bienveillant : « illuminé ». Nous avons, enfin, ceux typiquement à la mode comme « réactionnaire ». En l’occurrence, si nous voulons passer pour un expert de la gâchette verbale au cours des « buffets dînatoires » pour bourgeois bohèmes bien pensants, il faut opter pour la formule raccourcie : « réac ».
Si je pense que, par certains côtés, nous pouvions vivre mieux quand le mobile n’existait pas alors je suis automatiquement un réac.
Évidemment, nous avons des réactionnaires plus fréquentables que d’autres. Un Lorànt Deutsch, par exemple, passe encore à la télévision « malgré » ses livres sur l’histoire de France avec une approche monarchiste. Toujours est-il qu’en 2013 sur le plateau de l’émission de télé nommée Touche pas à mon poste, tandis qu’il nous rappelait ce qui, pour moi, est une banalité – « On est les héritiers d'une histoire ! » –, il a reçu comme réponse entre autres un « Non, ça c'est réactionnaire ! » de la part du journaliste Gilles Verdez. Précisons que, dans la bouche d’un distributeur médiatique de brevets de « bonnes vertus » modernistes et mondialistes, un réactionnaire est accessoirement un raciste donc un nazi, confondu avec un facho – abréviation de « fasciste » –, laissant donc entendre que nazisme et fascisme c’est exactement la même chose (à ce propos, vouloir apporter des nuances historiques par simple amour de la vérité est bien entendu suspect).
Pourtant, en utilisant à tire-larigot le terme de « facho », ne banalisons-nous pas ce que peut comporter de moralement nuisible l’idéologie fasciste authentique ? En outre, s’il y avait réellement autant de fascistes représentés par ceux que la gauche du Politiquement correct surnomme fachos, je pense que nous serions encore sous un régime de chemises noires. Comme ce n’est pas le cas, nous pouvons en déduire facilement qu’un certain nombre de personnes qualifiées de fachos ne sont pas fascistes. Une remarque analogue à propos d’une autre abréviation : très souvent aujourd’hui, le professeur est un prof. Certes, dans ce cas, celui qui est qualifié de prof est généralement un vrai professeur, un individu exerçant le métier d’enseignant. Je constate toutefois que c’est historiquement quand l’autorité du professeur s’est bien affaiblie que ce dernier est devenu un simple « prof ». (Cela ne sous-entend pas que j’idéalise l’école d’antan.) En conséquence, parler de facho et de prof nourrit le mépris des rôles éthiques de l’histoire et de l’enseignant.
Sans vérifier, je parie quand même que, dans le dictionnaire – pardon, dans le dico –, fasciste et facho n’ont pas le même sens. Au passage, à défaut de fréquemment consulter le dictionnaire papier comme autrefois, nommons-le dico. En résumé, le professeur et le dictionnaire, en perdant de leur prestige culturel, étaient prêts à ne devenir qu’un prof et un dico. En suivant la même logique, nommons donc fachos un ensemble hétéroclite d’individus – notamment les « cathos tradi », les monarchistes
et puis, pendant que nous y sommes, tous les opposants à la Gestation Pour Autrui – sans savoir vraiment ce dont retourne historiquement le fascisme. Louison Chimel, Les Cahiers d'un Anarchiste conservateur
13:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
18/01/2016
Un rétroviseur, ça doit servir ! (2/4)
 À côté de cela, nous avons des zones rurales de plus en plus désertiques. Bien sûr, il faudrait territorialement répartir autrement les populations. Ce qui peut justifier que le lieu géographique idéal de la postmodernité est la campagne. À partir de là, les postmodernes seraient en particulier des anciens urbains devenant des néo-ruraux, s’alliant avec ceux qui, quant à eux, n’ont jamais cessé d’être des ruraux, qui leur feront découvrir les joyeuses connexions avec l’esprit de la nature afin de vivre en harmonie avec elle. La campagne, avec ses petits villages regroupés devenant des communes authentiques, pourrait ensuite servir d’exemple-levier en termes de conscience locale, citoyenne (avec la démocratie directe) et sociale (avec l’entraide organisée en associations et coopératives). Historiquement, quoi qu’il en soit, la vie rurale s’est fréquemment organisée de façon confédérale.
À côté de cela, nous avons des zones rurales de plus en plus désertiques. Bien sûr, il faudrait territorialement répartir autrement les populations. Ce qui peut justifier que le lieu géographique idéal de la postmodernité est la campagne. À partir de là, les postmodernes seraient en particulier des anciens urbains devenant des néo-ruraux, s’alliant avec ceux qui, quant à eux, n’ont jamais cessé d’être des ruraux, qui leur feront découvrir les joyeuses connexions avec l’esprit de la nature afin de vivre en harmonie avec elle. La campagne, avec ses petits villages regroupés devenant des communes authentiques, pourrait ensuite servir d’exemple-levier en termes de conscience locale, citoyenne (avec la démocratie directe) et sociale (avec l’entraide organisée en associations et coopératives). Historiquement, quoi qu’il en soit, la vie rurale s’est fréquemment organisée de façon confédérale.
Un certain nombre de personnes chez qui je n’ignore pas les « fortes convictions » aiment affirmer qu’il faut accepter que le Monde « change », ou « avance », comme il est en train de « changer », ou « avancer ». Seulement voilà, nous pouvons très bien « changer en mal » ou encore « avancer dans le mur ». Sans que, pourtant, il évolue dans un confort économique, matériel ou mental particulier assuré par des modalités institutionnelles, techniques ou éthiques en cours, qu’un quidam soit si attaché à l’idée de « vivre avec son temps » peut parfois relever d’une peur, chez lui, de se retrouver seul à défaut d'être soi-même.
L’anarchiste conservateur, avec son sens de l’histoire, est amené à faire régulièrement des comparaisons entre présent et passé dans le but de faire, dans le monde actuel, la distinction entre ce qui nous fait perdre et ce qui nous gagner en liberté, en considérant éventuellement – au risque de donner des boutons à tout progressiste dogmatique – qu’il existe des choses qui étaient « mieux avant ». (1)
Ceci étant dit, il ne s’agit pas, bien sûr, d’idéaliser le passé puisque, pour prendre quelques exemples :
– la modernité fournit une technicité salutaire dans le domaine de la médecine ou de l’aménagement de la vie matérielle pour les personnes à mobilité réduite – pour peu, cependant, qu’elles vivent dans des pays riches. Par contre, au nom de l’utopie d’un monde sans armes, les « progrès » techniques dans le domaine militaire peuvent toujours être jugés regrettables ; à moins que l’ensemble des États du Monde soient dans une posture de dissuasion généralisée, ce dont nous pouvons toujours douter quand certains d’entre eux restent beaucoup plus armés que d’autres ;
– depuis la mort du nazisme, sans pour autant négliger l’émergence actuelle de mouvements politiques comme le parti grec Aube dorée se réclamant ouvertement d’icelui, nous pouvons trouver qu’en Occident, globalement, le racisme sous toutes ses formes a perdu du terrain ;
– il existe actuellement une prise de conscience inédite en matière d’écologie même si, bien sûr, elle succède à un laisser-aller généralisé et lui-même inédit durant le siècle dernier, relatif à l’ensemble des phénomènes d’industrialisation cherchant parfois à être justifiés par une rhétorique libérale moderniste qui concrètement appuie les intérêts du Grand capital ;
– nous pouvons trouver qu’il existe, parmi les classes populaires occidentales, un plus grand respect de l’individualité qu’autrefois. En même temps, ce progrès est à double tranchant. Car la défense de l’individualité – autrement dit, de l’unicité individuelle – ne doit pas abîmer la Décence ordinaire, sens de la solidarité et celui, s’il existe encore, de la fraternité. Néanmoins, défendre l’individualité n’est pas défendre le droit de faire tout et n’importe quoi en écoutant seulement nos désirs. Par exemple, il ne faut pas remettre en cause le droit de la filiation sous prétexte qu’il existe de nouvelles techniques de procréation avec, comme conséquences, une marchandisation de l’enfant.
Nous pouvons, par contre, trouver que le concept d’individualité n’est pas adapté aux sociétés tribales. Or, l’individualité n’est pas absente dans ces dernières dans le sens où la solidarité qu’on y retrouve ne découpe pas l’homme de de ce qu’il est. Au contraire, nous sommes d’autant plus humains que nous sommes solidaires. Ainsi, nous nous trouvons, ou retrouvons, davantage, nous déployons notre individualité – à travers les caractéristiques propres à notre personnalité – à mesure que nous sommes des humains dans la complétude humaine, évidemment empreinte de moralité et de spiritualité.
L’individualité, donc, n’est pas à promouvoir sous l’étiquette de l’individualisme libéral (déjà abordé plus haut) – avec individualisation des rapports sociaux devenant égoïstes sinon nuls – faisant des êtres soumis à l’ultralibéralisme – avec atomisation des individus devenant de pitoyables névrosés consommateurs. À l’opposé de la complétude humaine, de l’accomplissement de la décence intégrale, il y a l’homme qui n’est que l’ombre de lui-même.
Les dirigeants de ce Monde usent « intelligemment » de notions positives – en phase, en d’autres termes, avec l’idée d’émancipation – pour tromper les populations. De là, attention à ce qu’ils n’attisent pas, par exemple, notre égocentrisme plutôt que notre individualité. De toute façon, cette dernière se révèle par un travail conscient sur nous-mêmes et non pas en nous remettant à un tiers censé savoir qui nous sommes. Plus largement, les dirigeants politico-médiatiques peuvent malhonnêtement nous faire croire que nous sommes libres de ceci ou de cela. En termes, par exemple, de liberté d’expression, nous pouvons facilement constater qu’il existait encore dans les années 1980 des émissions T.V. et des journaux avec une liberté de ton inouïe par rapport à ce qui nous est proposé aujourd’hui. Pour calmer les colères populaires d’un côté, profiter des êtres déjà à moitié endormis de l’autre côté, les élites mondialisées entendent serrer la visse s’il le faut pour faire perdurer leur domination.
En vérité, l’anarchisme conservateur doit être un positionnement précurseur de la postmodernité. La modernité est incontournable. Il ne s’agit pas d’être réactionnaire et de l’ignorer mais de la dépasser dans le but de, en reprenant mes précédents points :
– réhabiliter une grande liberté d’expression pour la santé du débat public. Quelle que soit la dictature, elle est amenée à malmener cette liberté. Dès que nous considérons que nous sommes dans une dictature ultralibérale, nous devons être vigilants en matière de liberté d’expression, en n’attendant point, évidemment, la permission de parler mais en prenant tout bonnement la parole. « La liberté appartient à ceux qui l’ont conquise. » (André Malraux). Il faut également dénoncer la technique qui vise à criminaliser l’arrière-pensée ; c’est-à-dire à juger l’autre non pas sur ce qu’il a fait ou dit mais sur ce que, soi-disant, il voulait dire (2) ;
– concevoir l’individualité à travers les vertus de la Décence ordinaire, en les mettant publiquement en avant, pour lutter notamment contre l’indécence sociale et économique en général, « l’indécence extraordinaire des dominants » (3) en particulier (expression orwellienne). Parmi ces vertus, précisons ici l’antiracisme apaisé et fraternel, à opposer à l’antiracisme communautarisé (oxymore) et institutionnalisé de l’oligarchie en place qui hiérarchise et ethnicise les souffrances historiques dans le but
de maintenir sa domination en entretenant des divisions populaires. Attention à l’invention de problèmes ou l’extrapolation de situations relatives à des questions de discriminations reposant sur ce que sont les individus et qu’ils n’ont pas choisis (couleur de peau, physique, sexe). Sur le plan professionnel, il faut, bien entendu, combattre la discrimination à l’embauche et utiliser, pourquoi pas, les C.V. anonymes. Sur le plan historique, l’honnêteté nous amène à avoir un positionnement équilibré entre, par exemple, la conscience de l’existence passée de politiques racistes (traite négrière, nazisme) et l'actuelle manie victimaire comme éventuel objet de manœuvre politique. Ce sont aux classes populaires de montrer l’exemple dans la vie de tous les jours et de ne point se soumettre à l’instrumentalisation politicienne relative entre autres aux précédentes problématiques ;
– préserver la nature et concilier un certain écologisme avec l’idéal confédéraliste et le système économique préférable pour ce dernier : le socialisme autogestionnaire ;
– défendre un positionnement géopolitique confédéral et pacifique à l’égard de l’ensemble des peuples du Monde en opposition à toute théorie promouvant un gouvernement mondial puisque, forcément il sera seulement le pouvoir et la vision de quelques uns. D’où la nécessité de considérer la sensibilité patriotique et internationaliste comme opposée à l’idéologie mondialiste. Louison Chimel, Les Cahiers d'un anarchiste conservateur
13:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
14/01/2016
Un rétroviseur, ça doit servir ! (1/4)
En allusion à « l’éloge du rétroviseur » réalisé par Jean-Claude Michéa dans l’un de ses ouvrages, expliquons que le rétroviseur – en politique mais aussi dans la vie quotidienne – est un objet capital afin d’avoir une bonne conduite. En tant que dispositif permettant, à bord de notre auto, de voir derrière nous, le rétroviseur nous assure une plus grande sécurité.
Effectivement, pour avancer en toute sécurité, il faut savoir regarder régulièrement dans ses rétroviseurs. Il ne s’agit pas de faire un éloge du passé mais de savoir regarder le passé pour mieux aborder l’avenir. En ce qui concerne l’anarchiste conservateur, il cherche bel et bien à avancer mais tout en prenant en compte les bienfaits du passé. Le réactionnaire, en revanche, cherche plutôt à reculer, à simplement remonter le temps.
Certes, savoir conduire, c’est savoir entre autres reculer. Mais, en voiture, nous avançons beaucoup plus que nous reculons ! Nous regardons dans le rétroviseur plus souvent pour avancer en toute sécurité (anarchiste conservateur) que pour reculer (réactionnaire).
Nous reculons surtout, à vrai dire, pour nous garer. Comme, dans nos pensées, nous remontons quelquefois le temps, nous cherchons à revivre des souvenirs et cela nous rend heureux : c’est la nostalgie. Puis vient le moment de revenir au temps présent et de continuer notre route…
Si je ne regarde jamais derrière moi, je m’entraîne malheureusement à oublier d’où je viens. Sur un plan moral alors, je renie mes erreurs. Sur un plan intellectuel, difficile de cumuler consciemment des connaissances.
Savoir regarder derrière nous, c’est – sur un plan plus social, relationnel, sentimental – vouloir aujourd’hui rééditer de bons moments passés. Pas tous, car nous savons que nous ne pouvons remonter le temps. Mais pas d’amitié profonde sans souvenirs, sans les cultiver un minimum dans les esprits, sans retrouvailles pour les prolonger. Cela relève d’une volonté initiale de conserver. Justement, George Orwell nous rappelle bien que conserver permet de développer. Le philosophe contemporain Bruce Bégout, auteur d’un essai sur ce dernier, nommé De la décence ordinaire, nous dit : « La préservation de certains aspects doux et bons de la vie ordinaire doit servir de base pour une transformation sociale allant dans le sens de l’extension des valeurs telles que l’égalité, le respect, la décence, etc. » (Entretien sur le site internet Article 11 du 22 décembre 2009) Conservateur oui, mais anarchiste également ! Sur le terrain politique, il y a volonté de généraliser la dignité, par une anthropologie de l’honneur et de la droiture mais aussi de la générosité et de la politesse.
J’en reviens à mon rétroviseur. Si, sur la route, je ne regarde jamais à l’intérieur de celui-ci, j'ignore les risques qu’on me rentre dedans. Le conducteur derrière moi va peut-être plus vite que moi. Il est un danger pour moi comme d’ailleurs, étant donnée ma vitesse, je peux être un danger pour lui, même si, dans ce cas, il vaut mieux que nous allions tous les deux moins vite. En conséquence de quoi, le rétroviseur permet de mieux respecter l’autre en prenant en compte son évolution. En même temps, en roulant devant lui, c’est comme si nous lui montrions le chemin, éclairions la voie.
Si maintenant je recule en ignorant le rétroviseur, je suis tel ce réactionnaire ne respectant pas les autres qui ne partagent pas sa position. L’ordre ancien qu’il défend devient trop inadapté à l’ordre actuel tant il se découpe de l’humanité qui évolue avec lui et dont, qu’il le veuille ou non, il fait partie.
En même temps, en utilisant bien sûr le rétroviseur, aller parfois en arrière, c’est, selon certains, aller de l'avant ! Autrement dit, l’anarchiste conservateur est amené à considérer que la liberté est plus à redécouvrir qu’à découvrir. Il est le gardien du temple des libertés passées ; ces libertés perdues que nous trouvions autrefois, que nous retrouvons encore, dans les endroits reculés, à la campagne, où ni la police de la pensée ni la police proprement dite surveillent à tout bout de champ la conduite des gens ordinaires. D’où cette pensée, plutôt radicale, d’Edward Abbey dans son livre Désert solitaire en 1968 : « Nous avons besoin de la nature », d’un « refuge même si nous n'aurons peut-être jamais besoin d'y aller. Je n'irai peut-être jamais en Alaska, par exemple, mais je suis heureux que l'Alaska soit là. Nous avons besoin de pouvoir nous échapper aussi sûrement que nous avons besoin d'espoir ; sans cette possibilité, la vie urbaine pousserait tous les hommes au crime ou à la drogue ou à la psychanalyse. »
Les pensées traditionnelles ont très généralement des postures raisonnables et des intentions protectrices à l’égard de la nature. D’où, chez l’anarchiste conservateur, un certain intérêt pour elles sinon pour les traditions elles-mêmes qui font vivre une part de liberté :
– collective à travers le lien social qu’elles font maintenir ;
– plus intérieure et individuelle par leur éventuelle dimension créative (je pense à l’artisan inscrit dans une certaine tradition locale).
Certaines villes, elles, sont devenues des mégapoles, avec une incroyable concentration de populations dont, majoritairement, l’origine est forcément « importée » puisque, sur les terres en question, il n’y avait autrefois qu’une ville ou cité. Importation concernant immigrés ou anciens ruraux, le lien social est à recréer. Mais, à l’inverse des sociétés traditionnelles – avec leurs familles, clans et tribus –, l’identification à un groupe social est plus difficile dans les zones urbaines émanant de la modernité capitaliste. La notion de citoyenneté, pour sa part, semble, en vérité, toujours plus adaptée à ces dernières zones qu’à des schémas traditionnels. Mais, dans les deuxièmes et compte tenu du sens de la communauté qui y est retrouvable, le fonctionnement politique et civique intègre la prise de décisions à plusieurs et, plus globalement, des comportements démocratiques même s’il s’agira alors, au-delà de l’échelon familial, de représenter une voix par famille au niveau du champ décisionnaire clanique puis une voix par clan au niveau du champ décisionnaire tribal.
Le sens de la communauté – avec sa volonté collective d’établir une vérité commune et de défendre un intérêt commun – est ancré dans les sociétés traditionnelles. C’est comme si, par contre, il avait fallu faire redécouvrir tout cela aux populations urbanisées, regroupées dans des chaînes d’immeubles. D’où la citoyenneté de notre modernité républicaine, dont les origines théoriques a des vertus – par exemple, sous la plume d’un Jean-Jacques Rousseau – mais qui va, en même temps, nourrir un individualisme libéral invitant l’individu à se défaire des « chaînes » qui le liait jusqu’ici à des groupes sociaux de petite taille, avec un mépris culturel suprémaciste qui fait le pont entre un Benjamin Constant et un Jules Ferry, entre le début et la fin du XIXe siècle. Ainsi – compte tenu, en plus, de la ploutocratisation des institutions depuis maintenant quelques siècles –, le salut ne peut être dans la tribu mais dans cette citoyenneté qui fait de l’homme moderne un simple électeur qui ne doit pas lui-même écrire la constitution avec ses voisins, ni les lois. Il ne doit pas non plus chercher à mettre en avant un corpus précis de valeurs dépassant la laïcité comme simple contrat de cohabitation et de respect mutuel de soumission à la Loi du Marché. Ce sont pourtant ces précédents « groupes sociaux de petite taille » qui assurent l’heureuse socialité primaire et protègent l’homme d’une anthropologie libérale consistant à tout considérer comme un échange marchand, avec son « tempérament » d’essence atomisée et consommatrice.
Car, en effet, cet homme – qui devait être « supérieur » à celui « survivant » dans les sociétés qualifiées de primitives au nom de la précédente médisance suprémaciste – semble bien isolé et malheureux. Il est à même, en outre, de côtoyer cette pauvreté massive et urbanisée, forcément inédite dans l’histoire de l’humanité. Louison Chimel, Les Cahiers d'un anarchiste conservateur
13:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
10/01/2016
Point de la semaine : notre incapacité politique (partie 4)
Dernier point de la semaine associé aux autres réunis sous le nom de « notre incapacité politique ». Je fournis ici des informations répondant à quelques questions concernant l’idéal confédéraliste (ou fédéraliste intégral).
DE L’AN-ARCHIE, L’ORDRE JAILLIT
D’abord, ce dernier remet-il en question l’existence de l’État ? Pour répondre, je m’en remets à l’un des principaux théoriciens du fédéralisme intégral, ce cher Pierre-Joseph Proudhon. Lui, ne remet pas totalement en cause l’existence étatique. À vrai dire, qu’importe, selon lui, comment nous l’appelons… Dans ses Confessions d’un révolutionnaire, il nous dit en effet : « Le gouvernement, l’État, le pouvoir, quel que soit le nom que vous lui donniez, ramené à ses justes limites, qui sont, non de légiférer ni d’exécuter, pas même de combattre ou de juger, mais d’assister, comme commissaire, aux prêches, s’il y a des prêches ; aux débats des tribunaux et aux discussions du parlement, s’il existe des tribunaux et un parlement ; de surveiller les généraux et les armées, si les circonstances obligent de conserver des armées et des généraux ; de rappeler le sens des lois et d’en prévenir les contradictions ; de procurer leur exécution, et de poursuivre les infractions : là, dis-je, le gouvernement n’est autre chose que le proviseur de la société, la sentinelle du peuple. »
En fait, à partir de là, pour Proudhon, « le gouvernement n’existe plus, puisque, par le progrès de leur séparation et de leur centralisation, les facultés que rassemblait autrefois le gouvernement, ont toutes, les unes disparu, les autres échappé à son initiative ».
Ainsi, « de l’an-archie est sorti l’ordre ». Nous obtiendrions plus précisément :
– « la liberté des citoyens, la vérité des institutions, la sincérité du suffrage universel, l’intégrité de l’administration, l’impartialité de la justice, le patriotisme des baïonnettes, la soumission des partis, l’impuissance des sectes, la convergence de toutes les volontés » ;
– une société « organisée, vivante, progressive ; elle pense, parle, agit comme un homme, et cela précisément par ce qu’elle n’est plus représentée par un homme, parce qu’elle ne reconnaît plus d’autorité personnelle, parce qu’en elle, comme en tout être organisé et vivant, comme dans l’infini de Pascal, le centre est partout, la circonférence nulle part ».
UNE CENTRALISATION POSITIVE
Une seconde interrogation peut porter sur le degré de décentralisation des pouvoirs politiques dans la confédération nationale (logique qui peut s’étendre au monde entier). Si le fédéralisme en question est dit intégral, c’est pour invalider totalement l’actuelle pyramide des pouvoirs en vigueur et réaliser leur décentralisation maximale. Ce qui reste de pouvoir à un échelon territorial supérieur est ce que veulent bien déléguer les citoyens à l’échelon inférieur, avec un contrôle permanent et une possible remise en cause par eux-mêmes de ce qui est délégué — remplacement du mandat représentatif par le mandat impératif.
Si cette remarque vaut pour le volet politique, il vaut également pour celui économique. L’autogouvernement en politique vaut l’autogestion dans le domaine professionnel et économique.
En son temps, Pierre-Joseph Proudhon (à nouveau lui) a beaucoup critiqué la concentration des pouvoirs nationaux par le centralisme étatique (hérité du jacobinisme).
Or, voyons ici que, toujours dans ses Confessions d’un révolutionnaire, il associe ce centralisme au despotisme et à l’insidieux processus de représentativité et défend en contrepartie un autre « mode » (mot qu’il emploie) de centralisation. De cette façon, Proudhon oppose deux types de centralisation :
– celle des États « despotiques et représentatifs » qui est « l’autorité, héréditaire ou élective, qui du Roi, Président ou Directoire descend sur le Pays et absorbe ses facultés » ;
– celle reposant sur le contrat, celle des sociétés « d’hommes libres, qui se groupent suivant la nature de leurs industries ou de leurs intérêts, et chez lesquels la souveraineté, collective et individuelle, ne s’abdique ni ne se délègue jamais ».
Dans le second cas, « l’unité sociale, au lieu de résulter [comme dans le premier cas] du cumul et de la confiscation des forces par un soi-disant mandataire du peuple, est le produit de la libre adhésion des citoyens. En fait et en droit, le Gouvernement, par le suffrage universel, a cessé d’exister ».
D’où la centralisation proudhonienne s’effectuant « de bas en haut, de la circonférence au centre », avec autonomie de toutes les fonctions administratives se gouvernant, en effet, « chacune par elle-même ».
DE LA CENTRALISATION POSITIVE AU DEGRÉ SALUTAIRE D’UNITÉ NATIONALE,
DE CETTE UNITÉ A LA MONARCHIE POSITIVE
Tout phénomène de centralisation dépend d’une certaine unification. Ainsi, la précédente centralisation positive dépend forcément d’un degré salutaire d’unité nationale. On peut juger que le fédéralisme intégral — soit ce confédéralisme absolu — défendu par Proudhon détricote de trop l’unité nationale ; ce qui, au passage, met de côté tout mythe nécessaire à l’unification en question.
D’où la solution monarchique conçue comme « l’anarchie plus un » par l’école néo-monarchiste de l’Action française. Si nous voyons, dans cette « anarchie plus un », l’incontournable prolongation de « l’anarchie positive » de Proudhon — au nom de ce qui a été dit précédemment mais aussi, et tout simplement, de la dose nécessaire de stabilité institutionnelle —, comment définir raisonnablement le rôle d’un nouveau roi de France ?
Le roi est à même d’incarner :
– l’indépendance et la souveraineté du pays, qui reposent sur la faculté de la France à battre sa propre monnaie, faire ses propres lois, assurer l’indépendance de son système judiciaire (non soumis à des instances supranationales) et de son armée destinée avant tout à assurer la paix civile et non à faire des guerres en dehors de ses frontières en ne respectant pas la souveraineté des autres pays ;
– une continuité historico-éthique nationale, les spécificités de la civilisation française, la mémoire des hommes et des femmes ayant résidé sur le territoire national, avec leurs luttes émancipatrices et leurs positions garantissant la décence ordinaire ;
– les principes moraux non négociables, retrouvables dans la constitution nationale, assurant l’équité entre tous les Français, les traitements impartiaux et sans discrimination ;
– les vertus à la fois cardinales et théologales, au nom des origines philosophiques et religieuses de la France – de l’éthique des Grecs de l’Antiquité et du paganisme au catholicisme.
Le roi peut :
– avoir un pouvoir très limité. Il donne son avis dans l’intérêt du peuple pouvant l’appuyer et, souverainement, choisir l’option royale ;
– même être une autorité sans pouvoir particulier, comme certains chefs de tribu mélanésienne. Ce sont ces « hommes d’influence » dont il est collectivement reconnu le prestige. Ce dernier se retrouve, chez le roi, à travers entre autres ses capacités à servir (non à se servir) et à protéger (non à veiller à ce que son statut soit conservé puisqu’il est roi jusqu’à la mort). Autrement dit, le roi ne cherche pas à faire carrière. Son avenir politique est tout tracé. Il peut, par conséquent, se dévouer au bien de son peuple. « Le droit du peuple consiste dans cet ensemble de libertés publiques maintenues et développées par des générations qui, en reconnaissant le Roi, n'entendent pas se donner un maître de leurs personnes et de leurs biens, mais un protecteur de leurs droits. » (François-René de La Tour du Pin, Vers un ordre social chrétien) L’autorité du roi coule de source. Elle est évidente aux yeux, et dans le cœur, des Français.
Quant à ces derniers, les sujets du royaume de France, nous pourrons toujours les nommer citoyens dans la mesure où la monarchie défendable n’est pas, pour moi, n’importe quelle monarchie. Elle est une monarchie constitutionnelle et fédérative. Son principe fédératif peut se définir en s’inspirant beaucoup des thèses proudhoniennes (que je continue à défendre indépendamment de la solution monarchique). Il faut, selon moi, établir toutes les jonctions éthiques et institutionnelles possibles entre les précédentes « anarchie positive » et monarchie comme « anarchie plus un » ; entre leurs deux intégralismes, respectivement fédéraux et nationaux (*).
De cette façon, les Français seront toujours plus des citoyens dans cette monarchie que dans notre actuelle république agonisante. La première sera démocratique quand la seconde est ploutocratique. La monarchie que je décris cherchera vraiment à se concilier avec ce que désigne authentiquement la res publica. L’administration royale garantira, par conséquent, l’autodétermination des provinces françaises et la démocratie directe maximale, à tous les échelons territoriaux du pays. Le peuple, de son côté, reconnait, en le roi, le symbole de la :
– dimension unificatrice des régions françaises ;
– de la consistance d’une réalité française, héritière politiquement de ses monarchies, empires et républiques, culturellement de traditions locales diverses, d’un savoir philosophique et scientifique, d’un savoir-faire artisanal et artistique exceptionnels.
(*) À noter que Proudhon n’a jamais été monarchiste mais – dans De la Justice dans la Révolution et dans l’Église (1858) –, affirmant son patriotisme, il n’exclut pas la solution royaliste : « Je veux, autant qu'un autre, la gloire du nom français ; je ne repousserais pas le triomphe de mes principes et le bonheur de ma nation, parce qu'elle me viendrait d'un empereur ou d'un roi. » Comparant, par ailleurs, la Monarchie et la République françaises, il écrit : « Religion pour religion, l'urne populaire est encore au-dessous de la sainte-ampoule mérovingienne. Tout ce qu'elle a produit a été de changer la science en dégoût, et le scepticisme en haine. » Comparaison et préférence confirmée dans Du principe fédératif (1863) : « Ôtez de l’ancienne monarchie la distinction des castes et les droits féodaux ; la France, avec ses États de province, ses droits coutumiers et ses bourgeoisies, n’est plus qu’une vaste confédération, le roi de France un président fédéral. C’est la lutte révolutionnaire qui nous a donné la centralisation. » Nous savons, de toute façon, que Proudhon tient pour responsable la République de la centralisation qu’il critique avec virulence et à raison selon moi.
Le Bisontin a également écrit : « Un homme qui travaille à assurer sa dynastie, qui bâtit pour l’éternité est moins à craindre que des parvenus pressés de s’enrichir et de signaler leur passage par quelque folie d’éclat. » (De la création de l'ordre dans l'humanité ou Principes d'organisation politique) Je trouve qu’on peut, par contre, élargir cette dernière idée aux hommes de la vie ordinaire – bons pères de famille, entrepreneurs sociaux, créateurs moraux, virtuoses vertueux – soucieux de laisser derrière eux un bel héritage, éventuellement matériel (même modeste) mais toujours spirituel. Louison Chimel (reprenant des parties de ses Cahiers d'un anarchiste conservateur, à paraître)
14:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
04/01/2016
Point de la semaine : notre incapacité politique (partie 3)
 Bonne année ! Que cette année soit, le plus possible, une année d’éveil des consciences et des volontés dissidentes de défendre activement sa Cité, sa région, notre pays la France !
Bonne année ! Que cette année soit, le plus possible, une année d’éveil des consciences et des volontés dissidentes de défendre activement sa Cité, sa région, notre pays la France !
Dans le modèle confédéral que je préconise, les institutions seront telles que nous gérerons nous-mêmes le bien de la Cité. Nous occuper du bien de la Cité ne doit pas, bien sûr, occuper tout notre temps. Seulement, je suis sûr que beaucoup de gens trouveraient cela attrayant, deviendraient passionnés par la cogestion de la vie publique – dépourvue, par ailleurs, de toute recherche de domination personnelle étant données les institutions confédérales qui seraient en vigueur.
Pour ce faire, il faut, c’est vrai, faire confiance, beaucoup confiance, à l’homme, à son bon sens, à son sens du bien commun. Seulement, je suis sûr, encore une fois, que la vertueuse pratique politique en question relève d’une nécessité – et va donc dans le sens de l’émancipation individuelle et collective – et ne serait alors vécue telle une contrainte.
Plus spirituellement parlant, s’occuper du bien de la Cité, c’est se reconnecter avec son humanité, dans son sens le plus digne et même le plus noble, par les vertus – qui alors irrigueraient à la fois notre cœur et la société – et par les heureuses conséquences sociales.
Au passage, nous pouvons juger que la précédente propension à faire confiance relève d’une naïveté étant donnée la corruptibilité humaine. Néanmoins, si nous considérons que le bon sens signifie vraiment quelque chose, si nous en avons une idée même plutôt abstraite mais qui donc se rapporte à notre spontanéité éthique, c’est qu’il est encore retrouvable dans des proportions intéressantes. Car il réside déjà dans cette spontanéité, qui est aussi la vision intuitive d’une bonne conduite, d’une socialité forcément en adéquation avec la dignité partagée.
De cette façon, nous pouvons dire que l’origine du bon sens se situe dans notre âme ayant fourni à l’esprit la moralité, dans notre sentiment inné de ce qui est juste. Ce dernier, nous pouvons le juger ancré plutôt qu’inné dans le sens où il est transmis entre générations.
Il n’empêche qu’à cause de la précédente corruptibilité – attisée de diverses façons dans notre société moderne ultralibérale ayant très peu de rapport avec les libertés authentiques – la confiance en la pérennité du bon sens retrouvable chez beaucoup d’individus ne doit pas nous détourner d’une certaine vigilance amenant à défendre la notion d’héritage prise ici dans sa dimension éthique en particulier. De plus, afin de faire société, il faut sans doute perdre un peu de liberté relative à notre essence, qu’elle soit naturelle (animalité) ou culturelle (individualité). Et, en même temps, la deuxième se parfait dans l’existence qui prend tout son sens dans la vie sociale, dépendant nécessairement d’une conscience collective. Ce qui nous ramène à ce que nous dit le philosophe Jean-Jacques Rousseau et que je reformule ainsi dans mon dossier internet appelé Rousseau contre les Lumières : « Le passage nature-culture peut être positif dans une conscience préalable que la liberté toute sociale ne peut être conquise qu’en perdant une certaine part de liberté. »
Ce point de la semaine est dédié aux principes non négociables qui pourraient être introduits dans la constitution de la confédération au niveau national. Mes propositions :
– les principales libertés retrouvables dans les Droits fondamentaux dont certains peuvent être mis de côté car se confondant avec des droits « très libéraux ». Parmi eux, il y a ceux qui sont adaptés à une logique économique inéquitable, et d’autres que concrètement ne peut pas faire valoir, dans l’ordre économique et politique actuel, l’ensemble des citoyens. Il y a donc bien la nécessité de faire un tri et une mise à jour ;
– le respect de la souveraineté nationale. Soit la primauté du pouvoir politique de l’échelon territorial national sur celui continental et sur toutes les instances supranationales). Soit également la faculté de la France à battre sa propre monnaie, faire ses propres lois, assurer l’indépendance de son système judiciaire et de son armée destinée avant tout à assurer la paix civile et non à faire des guerres en dehors de ses frontières en ne respectant pas la souveraineté des autres pays ;
– l’égalité de traitement des citoyens devant la loi à chaque échelon de la confédération dont ils sont membres par leur nationalité et leur lieu de résidence ;
– l’égalité d’accès des citoyens à l’ensemble des services publics de santé ;
– l’Éthique de Réciprocité afin de mettre en avant la mutualité : « Ne faites pas aux autres ce que vous ne vous voudriez pas qu'on vous fasse ; Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. » Ce qui débouche sur la reconnaissance du régime des contrats (diplomatiques, institutionnels, économiques et sociaux). Préciser cette règle, c’est s’opposer à la facilité, entretenue par l’éducation du libéralisme, amenant à considérer que la mutualité est « l'affaire d'économie politique, non de gouvernement » (Pierre-Joseph Proudhon, De la Capacité politique des classes ouvrières) ;
– la maxime suivante : « À chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres. » Ce qui doit déployer, dans toutes les fédérations, un service public de reconnaissance de la qualité (combinant qualification et capacité) de tous les travailleurs. Ce qui transforme le mutualisme du point précédent en socialisme entendu comme société décente et donc société juste ;
– la protection de la force de travail contre la « force de capital », de l’économie réelle contre l’économie virtuelle ;
– l’interdiction, par n’importe quelle fraction citoyenne pourtant mandatée pour des actions bien précises par une partie du peuple, d'endetter la confédération dans le but de combler des intérêts privés ;
– l’assurance que l’ensemble des banques présentes sur le territoire de la confédération nationale soit nationalisé pour permettre leur mutualisation toujours à l’échelle nationale ;
Les principes énonçant des valeurs plutôt que les fonctionnements institutionnels pourraient être rassemblés dans une charte éthique intégrant la constitution confédérale.
Au nom de la démocratie, nous pouvons toujours, cependant, juger que les citoyens doivent avoir les moyens de proposer directement des modifications de la constitution de la confédération nationale. Nous pouvons, pour cela, nous inspirer du droit d’initiative populaire fédérale, trouvable en Suisse. Ceci est un droit constitutionnel extensible au domaine législatif et à tous les échelons territoriaux. C'est ce qui permet aux citoyens d’agir directement sur les constitutions et les lois aux échelons communaux, cantonaux, départementaux et régionaux. De toute façon, celles-ci, dans une confédération authentique, doivent déjà être les fruits de la volonté citoyenne.
Naturellement selon les échelons, la décision peut se prendre par l’intermédiaire de représentants de citoyens. Seulement, les mandats de ces représentants sont très cadrés afin que l’action menée par ceux-là corresponde le mieux possible à la volonté des citoyens qui les ont momentanément désignés. Un mandataire rapporte forcément la parole du citoyen qui l’a choisi. Les mandats en question ont des modalités particulièrement calquées sur le modèle du mandat impératif.
Nous savons, sinon, que la démocratie directe (donc la démocratie la vraie), c’est la mise en pratique de la recherche permanente d’un intérêt commun par les citoyens eux-mêmes. Tout intérêt commun :
– peut être considéré comme une somme (indéterminable exactement) de plusieurs autres intérêts communs (exemple : l’intérêt d’un département est la somme des intérêts convergents de ses communes). Ceux-là ne doivent pas seulement cohabiter mais s’interpénétrer au nom de la cohésion sociale ; interpénétration rendue possible par le double principe fédératif de la confédération nationale associant les individus comme à la fois des citoyens et des travailleurs. Un intérêt commun est fondamentalement la jonction d'intérêts individuels dont les points communs reposent d’abord sur les besoins physiologiques et sociaux élémentaires de tout individu. L’intérêt commun « de base » est dégagé à l’échelle d’une commune voire, déjà, d’un quartier quand, dans cette dernière, sont reconnus, avec leurs assemblées, plusieurs quartiers ;
– repose sur une vérité commune qui certes évolue – car une société n’est pas historiquement figée et les humains ne sont pas des robots à la mémoire préfabriquée – mais ne change pas non plus tous les quatre matins puisque, justement par notre mémoire et notre raison, nous aspirons à être des êtres constants et conséquents. D’ailleurs, la responsabilisation collective par la démocratie la plus vraie doit appuyer notre capacité à changer ce qu'il faut et conserver ce qu’il faut dans la société. De surcroît, la première redonne absolument sens à l’idée de bien commun, qui est cet intérêt permanent. Nous savons bien, par exemple, que, pour vivre, nous avons besoin d’avoir un toit et de manger régulièrement. Aussi, c’était valable hier et cela le sera demain : nous ne pouvons pas faire n’importe quoi avec la nature car elle nous permet notamment de respirer le bon air nécessaire à notre bonne santé physique – puis mentale et morale. En conséquence, il existe bien, selon les besoins constants de l’humanité, ce précédent intérêt permanent.
Et même si, une fois, des gens votent « mal » – faute de réalisme à propos, par exemple, des moyens économiques et techniques à fournir afin de lutter contre des phénomènes naturels matériellement dégradants –, ils seront logiquement mieux avertis et préparés la seconde fois. Apprendre réellement – puis maîtriser pour devenir responsable –, c’est éventuellement faire des erreurs et les comprendre pour ne pas les rééditer.
Nous verrons la prochaine fois ce que peuvent encore désigner l’État, la centralisation et l'unification du pays à travers ce modèle très décentralisé qu'est la confédération nationale. Louison Chimel
12:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |
24/12/2015
Divna Ljubojević - Agni Partene
11:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |
Facebook | |